Composition visuelle [architecture]
2 participants
Archi27 :: DPT d'Architecture :: Amphi :: Les Cours & Les TD :: 2eme année
Page 1 sur 1
![Composition visuelle [architecture] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Composition visuelle [architecture]
Composition visuelle [architecture]
Habiter la vision
Le mythe de la première maison, selon Joseph Rykwert
(1), serait celui raconté par Filarete où Adam, chassé du Paradis,
joint les mains au-dessus de sa tête pour se protéger des pluies
diluviennes. La maison serait ainsi née d’un geste, qui aurait
déterminé son anthropomorphisme récurrent, celui du besoin de
protection contre les éléments extérieurs. À la non-fondation de ce
geste nomade, s’oppose la fondation à travers la découpe d’un
territoire dans le continuum de l’espace chez Georg Simmel : "L’homme
qui le premier a bâti une hutte révéla, comme le premier qui traça un
chemin, la capacité humaine spécifique face à la nature en découpant
une parcelle dans la continuité infinie de l’espace, et en conférant à
celle-ci une unité particulière conforme à un seul et unique sens" (2).
Ces deux versions du mythe de l’origine de la maison font d’emblée
apparaître le dualisme entre la maison nomade, épousant les
déplacements du corps, et la maison sédentaire. La maison sera
irrémédiablement le nœud d’une logique binaire : nomade/sédentaire,
privé/public, individuel/collectif, rationnel/irrationnel,
intérieur/extérieur, refuge/inquiétude, comme si, en elle, s’incarnait
l’impossible réconciliation des contraires, comme si la maison
s’offrait comme un sujet barré entre conscient et inconscient, avoué et
interdit. Ce fonctionnement binaire, ce locus dissocié, aura pour
conséquence d’engendrer un sujet double, à la quête de son identité
dans une logique spéculaire. D’autre part, la maison est aussi un terme
isolé, une entité autarcique, close sur elle-même, à la différence de
la mobilité incessante de l’espace urbain, et apparaît comme une
modalité de repli sur une subjectivité. La maison deviendra le
laboratoire par excellence de l’espace subjectif, traversant les
définitions, de la "villa hégémonique" qui assure la suprématie du
privé sur la vie sociale jusqu’à celles de la maison post-moderne d’un
Robert Venturi, qui n’est plus qu’un signe extraverti sur le public.
La maison chez Benjamin, ou plutôt l’appartement, qui
recueille les traces d’une intériorité de plus en plus évanescente
nécessitant l’enquête policière pour les retrouver, exemplifierait la
transition entre la maison du XIXe siècle et la maison moderne. Pour
Benjamin, architecture et habitation ne se recouvrent pas : habiter
signifie "être-dans-une-enveloppe" qui porte l’empreinte de l’habitant.
La maison moderne, aux parois de verre, qui inaugure la dissociation
entre le moi privé et public, deviendra en même temps, pour Beatriz
Colomina (3), le nœud médiatique où se ramifie la vie moderne, traversé
par les nouveaux réseaux de communication (téléphone, télévision,
etc.). Les tréfonds obscurs de l’intériorité que recueillait jadis la
maison se sont ainsi transformés en espace-temps anamorphosé où
l’enveloppe opaque est devenue une surface réfléchissante, tournée vers
l’extérieur, qui a conféré une vie publique à l’habitant de la maison.
Le sujet dissocié du XIXe siècle a fait place au sujet médiatique et
rhizomatique de la modernité, où la dépropriation de la sphère privée
en publicité, ainsi que le démontre Beatriz Colomina, a condamné le
sujet au déplacement d’un site à l’autre, à la transience, à la
promotion de son nouveau statut d’intervalle.
"L’architecte comme le philosophe sont confrontés à
l’état de crise du rapport de l’homme à l’espace de son habitation"
(4). L’idée même de "demeure", au sens de demeurer, de s’inscrire dans
la durée, dans la temporalité de l’habiter, où la maison est
appréhendée comme séjour dans le temps, est bouleversée. Aujourd’hui,
on ne s’installe plus à ’demeure’. Pour Adorno, depuis la déportation,
les guerres mondiales, la maison n’est qu’une étape dans l’exil : "Il
est devenu tout à fait impossible d’habiter... Le temps de la maison
est passé" (5). La modernité aurait introduit l’émergence d’un sujet
mobile, contrastant avec la permanence de la maison. Cette question de
la possibilité de l’habiter avait été posée par Heidegger : l’homme
moderne n’habite plus car il souffre d’un "oubli du sens de l’être".
"Il semble que si la philosophie fait si souvent de l’architecture son
modèle, ce n’est pas seulement à partir de l’idée de système, de
construction fondée, c’est à partir de l’idée de demeure. Cela se
vérifie encore chez Heidegger, pour qui la pensée, dans le voisinage de
la poésie, est recueillement et abri de l’être, Heidegger qui désigne
la parole comme "maison de l’être" (6). Pourtant la maison comme "objet
phénoménal constant, isolé, immobile" est attaquée de toutes parts.
Pour Massimo Cacciari, la vie urbaine n’a plus rien à voir avec
l’habitation comme "wohnen", seule une architecture qui témoigne de
l’impossibilité de l’habiter peut encore avoir une certaine forme
d’authenticité, ainsi celle de Mies van der Rohe ("le langage de
l’absence témoigne ici de l’absence de l’habiter" écrit Cacciari).
Cette crise de l’habiter apparaîtra souvent dans l’art comme une crise
de la privacité. Ainsi, dans les vidéos de Tony Oursler, il est écrit
que "la seule façon de contrôler quoi que ce soit ici, ce serait de
quitter la maison" ; "la violence commence à la maison" (Private,
1993). La maison, quintessence du mythe de l’intérieur bourgeois, où
règnent le conventionnalisme, l’acceptation des valeurs, la répartition
homogène des rôles qui se dupliquent dans la vie sociale, est devenue
le lieu du conflit domestique, la scène émergente d’une crise de
l’identité. Violation / Transformation de Tony Oursler s’attaque de la
sorte au foyer monstrueux de cette déréliction : la télévision. La
"médiatisation" du sujet moderne aurait ainsi révélé la "violence du
domestique" (7) qui aurait à son tour provoqué l’extraction violente du
sujet hors de sa habitation. Quoi qu’il en soit, jamais la maison ne
sortira intacte de sa représentation : l’artiste s’en prendra non
seulement à son intégrité physique, mais une autre forme de violence se
fera jour : celle de la vision qui deviendra le paradigme d’une quête
impossible de l’habiter.
La maison : un reflet fracturé du miroir
Dans la littérature du XIXe siècle, la perception de la
maison est écartelée entre refuge et inquiétude. De la maison hantée du
romantisme gothique de Horace Walpole à celle, frémissant
d’"inquiétante étrangeté" ( de Hoffmann, des ruines abandonnées de
de Hoffmann, des ruines abandonnées de
Victor Hugo à l’effondrement de la maison Usher de Poe, du sublime de
William Burke, où la terreur est palpable jusque dans les recoins
obscurs de la maison, à l’Unheimlichkeit de Freud, de Walter Pater à
Walter Benjamin, le sujet se dédouble dans la terribilité de la maison.
Dans La Véranda de Herman Melville, la maison est devenue le sujet du
récit, construit entièrement sur un mécanisme de projection spéculaire.
La maison n’y relève que du registre du regard, jamais de l’habiter ;
le protagoniste se tient toujours à sa lisière, assis dans sa véranda,
d’où il contemple de l’autre côté de la colline les reflets d’une
maison idyllique au "pays des fées". La maison n’est plus inscription
dans un lieu défini, dans la durée du "demeurer", mais se projette dans
un ailleurs, au sein duquel le sujet se dédouble, propulsé hors de
lui-même, dans la quête de ce qui est inatteignable. Avant Melville, le
Landor’s Cottage d’Edgar Poe avait lui-aussi assimilé la maison à une
image de perfection absolue qui ne relevait que de l’ordre de la
vision : le cottage idyllique qui se détachait au milieu d’un paysage
incarnant la "perfection" n’est plus qu’une image, ultime garant du
bonheur, mais dont l’artificialité est le reflet de ce qui est
irrémédiablement perdu : l’habiter. Deux œuvres s’y réfèrent : la
maquette du "Landor’s Cottage" de Rodney Graham et "How to Remember a
better Tomorrow" d’Allen Ruppersberg, dont le titre repose sur une
temporalité contradictoire, "comment se souvenir d’un lendemain
meilleur". Dans l’œuvre de Ruppersberg, un cottage se détache au milieu
d’une pelouse verdoyante, parfaite incarnation de la vision stéréotypée
de la maison américaine. Une vidéo projetant des films publicitaires
des années 1950 vante le mode de vie familial idéal au sein du pavillon
américain. L’absence de foyer dans le cottage contraste avec la joyeuse
effervescence familiale des films qui apparaît comme un produit aussi
"préfabriqué" que le modèle standard de la maison. À nouveau la maison
n’est plus qu’illusion : la maquette parfaitement lissée du cottage,
qui fait écho aux images aseptisées des films promotionnels, émerge
d’une verdure taillée comme une reproduction. L’ensemble sécrète un
univers si idyllique qu’il en devient cauchemardesque et pose la
question : est-il encore possible d’habiter la maison ? La "vision" du
bonheur a ici pour unique ressort la déréalisation de l’habiter.
L’image de la maison générée par la maquette et celle du film
promotionnel se renvoient l’une à l’autre, comme à travers un miroir,
où s’efface la voix de l’habitant, où ne reste plus la maison que comme
simulacre d’un simulacre. L’objet originel nommé "maison" semble s’être
perdu dans les réflections d’une mise en abyme, dissocié en pure
phénoménalité, transformé en pur espace projectif "visionnaire".
Au début du XXe siècle, s’est opéré le passage d’une
modalité de vision à une autre. On pourrait avancer que si la camera
obscura peut se définir comme le modèle de vision du sujet du XIXe
siècle, ainsi que le suggère Jonathan Crary (9), elle s’identifierait
également au modèle de la maison, foyer obscur et impénétrable, au sein
duquel le sujet se dédouble et s’inverse (10). La modernité aurait
articulé le passage d’un modèle clos, projectif à travers le plan
d’interception du verre, en un modèle "transformatif", qu’explicitera
dans un autre registre Marcel Duchamp dans son Grand Verre (11) Cette
transition au cours de la modernité se signale dans un nouveau
dispositif de représentation de l’architecture où l’on passe du système
projectif de la perspective, auquel fait écho la camera obscura, à la
vue axonométrique, ainsi chez Theo van Doesburg dans le contexte du
néo-plasticisme. À l’inverse de la logique monoculaire qui impose un
sujet fixe, le sujet-observateur de la vue axonométrique surplombe un
espace découpé cliniquement dans lequel le bâtiment apparaît sans
fondations, flottant librement dans l’espace, à la manière de la
"Maison Domino" de Le Corbusier ou de la Maison Farnsworth de Mies van
der Rohe (12). À l’immobilisme du sujet, qui fixe un plan, a fait place
l’immersion du sujet au sein d’un espace-membrane ; au plan, s’est
substitué le volume, mais un volume qui spatialise la vision, la rend
extensible dans l’espace. Le passage de l’espace perspectiviste à
l’espace topologique de l’axonométrie au cours de la modernité est
aussi celui du sujet individué au sujet collectif, et peut-être la
transition de l’individuation de la maison à l’espace collectif de la
ville qui immerge le sujet.
Ce passage d’un mode de vision à un autre eut des
répercussions sur la politique de l’habiter, qui se manifeste également
à travers le bouleversement consécutif de la notion d’échelle. "Lorsque
la sculpture moderne passa de la représentation à l’abstraction, elle
passa de l’échelle spécifique à l’échelle non-spécifique. Lorsque la
sculpture cessa d’être anthropomorphique, alors son échelle cessa
d’être la dimension d’une représentation. L’architecture a toujours été
à l’échelle spécifique. L’échelle est l’axe crucial qui lie l’objet
architectural au sujet. Le modernisme exclura l’habitation de l’objet
réflexif". Jouer avec l’échelle de la maison dans l’art contemporain
sera une manière privilégiée de perturber son anthropomorphisme, son
individuation. En devenant "non-spécifique", l’échelle distendra
l’analogie entre la maison et le sujet qui l’habite. L’échelle fera
ainsi office de surface réfléchissante, comme les parois de verre
modernes, faisant refluer au dehors l’habitant. Échelle trop grande ou
trop étroite comme en témoigne la récurrence de l’objet maquette dans
l’art contemporain. La "Vanna Venturi House", à Chesnut Hill,
Philadelphia, en 1964, de Robert Venturi incarne bien cette prégnance
de l’échelle : cette petite maison utilise une échelle
disproportionnée, génératrice de la tension architecturale : "la façade
crée une image presque symbolique de la maison". Et Vanna Venturi, la
mère de l’architecte, s’y tient au dehors, pour la photographie, comme
refoulée par cette maison dont l’échelle ne correspond pas à la sienne,
qui a remplacé l’habiter par le dédoublement spéculaire de la maison en
façade, en signe, en échelle distendue, en mode scopique de vision.
L’immersion scopique du sujet
Si la maison se donne dans son altérité, on y pénètre
par le regard, par le fantasme. "La maison de Joséphine Baker" (1994)
de Dennis Adams est un aquarium dans lequel est plongée une maquette de
la maison à l’échelle 1 : 33. Cette maison avait été imaginée en 1928
pour Joséphine Baker par Adolf Loos, qui la conçut autour d’une piscine
sensée exalter le corps nu de Joséphine Baker. La fluidité de l’eau au
centre de l’architecture est le véritable occupant de la maison. Il
semblerait que cette maison n’ait d’ailleurs jamais été commandée par
Joséphine Baker, et ne soit qu’une pure émanation du désir de Loos. En
plongeant dans un réservoir d’eau la maquette de la maison, Dennis
Adams a rendu réversible ce regard de désir, jusque-là tourné vers
l’intérieur, vers l’apparition de Joséphine Baker au sommet des
escaliers menant à la piscine, où l’eau se réfracte dans la verrière.
"Hypnerotomachia" contemporaine, songe aquatique de Polyphile dans une
architecture fluidifiée en principe de désir, la maison projetée par
Loos évoque, pour Farès el-Dahdah (13), les dispositifs de désir, du
Petit Château de Choisy de Madame de Pompadour à la "petite maison" des
romans du XVIIIe siècle, comme ceux de Jean-François de Bastide, où la
maison était pensée comme machine de séduction. Chez Loos, les bandes
noires sur le marbre blanc renvoient, pour cet auteur, au corps rayé,
biffé de l’exotique Joséphine Baker, qui se répercute dans son
ineffable réflection dans l’eau et la lumière. Farès compare la maison
à un appareil photographique où l’idiosyncrasie de ses éléments
constitutifs obéit à un scénario voyeuriste. Au retrait de la féminité
qu’était le boudoir, fait place son immersion dans l’espace de la
maison à travers la piscine. Les miroirs d’eau et de lumière
transforment la privacité en spectacle : le corps s’expose, s’offre à
la vue dans la maison. D’habitation, la maison est devenue dispositif
de vision. L’invisible est devenu la réfraction haptique du visible où
le sujet devient un objet démultiplié dans son immersion scopique. La
maison comme mécanisme de vision et de désir fonctionne à travers
l’enjeu spéculaire du verre et de l’eau pour dissoudre le sujet privé
dans sa représentation à l’intérieur de l’espace privatif. La maison
serait ainsi ce modèle introverti, de plongée du sujet non pas dans son
intériorité, mais dans la réversion de son propre mode de vision (14).
Le mythe de la première maison, selon Joseph Rykwert
(1), serait celui raconté par Filarete où Adam, chassé du Paradis,
joint les mains au-dessus de sa tête pour se protéger des pluies
diluviennes. La maison serait ainsi née d’un geste, qui aurait
déterminé son anthropomorphisme récurrent, celui du besoin de
protection contre les éléments extérieurs. À la non-fondation de ce
geste nomade, s’oppose la fondation à travers la découpe d’un
territoire dans le continuum de l’espace chez Georg Simmel : "L’homme
qui le premier a bâti une hutte révéla, comme le premier qui traça un
chemin, la capacité humaine spécifique face à la nature en découpant
une parcelle dans la continuité infinie de l’espace, et en conférant à
celle-ci une unité particulière conforme à un seul et unique sens" (2).
Ces deux versions du mythe de l’origine de la maison font d’emblée
apparaître le dualisme entre la maison nomade, épousant les
déplacements du corps, et la maison sédentaire. La maison sera
irrémédiablement le nœud d’une logique binaire : nomade/sédentaire,
privé/public, individuel/collectif, rationnel/irrationnel,
intérieur/extérieur, refuge/inquiétude, comme si, en elle, s’incarnait
l’impossible réconciliation des contraires, comme si la maison
s’offrait comme un sujet barré entre conscient et inconscient, avoué et
interdit. Ce fonctionnement binaire, ce locus dissocié, aura pour
conséquence d’engendrer un sujet double, à la quête de son identité
dans une logique spéculaire. D’autre part, la maison est aussi un terme
isolé, une entité autarcique, close sur elle-même, à la différence de
la mobilité incessante de l’espace urbain, et apparaît comme une
modalité de repli sur une subjectivité. La maison deviendra le
laboratoire par excellence de l’espace subjectif, traversant les
définitions, de la "villa hégémonique" qui assure la suprématie du
privé sur la vie sociale jusqu’à celles de la maison post-moderne d’un
Robert Venturi, qui n’est plus qu’un signe extraverti sur le public.
La maison chez Benjamin, ou plutôt l’appartement, qui
recueille les traces d’une intériorité de plus en plus évanescente
nécessitant l’enquête policière pour les retrouver, exemplifierait la
transition entre la maison du XIXe siècle et la maison moderne. Pour
Benjamin, architecture et habitation ne se recouvrent pas : habiter
signifie "être-dans-une-enveloppe" qui porte l’empreinte de l’habitant.
La maison moderne, aux parois de verre, qui inaugure la dissociation
entre le moi privé et public, deviendra en même temps, pour Beatriz
Colomina (3), le nœud médiatique où se ramifie la vie moderne, traversé
par les nouveaux réseaux de communication (téléphone, télévision,
etc.). Les tréfonds obscurs de l’intériorité que recueillait jadis la
maison se sont ainsi transformés en espace-temps anamorphosé où
l’enveloppe opaque est devenue une surface réfléchissante, tournée vers
l’extérieur, qui a conféré une vie publique à l’habitant de la maison.
Le sujet dissocié du XIXe siècle a fait place au sujet médiatique et
rhizomatique de la modernité, où la dépropriation de la sphère privée
en publicité, ainsi que le démontre Beatriz Colomina, a condamné le
sujet au déplacement d’un site à l’autre, à la transience, à la
promotion de son nouveau statut d’intervalle.
"L’architecte comme le philosophe sont confrontés à
l’état de crise du rapport de l’homme à l’espace de son habitation"
(4). L’idée même de "demeure", au sens de demeurer, de s’inscrire dans
la durée, dans la temporalité de l’habiter, où la maison est
appréhendée comme séjour dans le temps, est bouleversée. Aujourd’hui,
on ne s’installe plus à ’demeure’. Pour Adorno, depuis la déportation,
les guerres mondiales, la maison n’est qu’une étape dans l’exil : "Il
est devenu tout à fait impossible d’habiter... Le temps de la maison
est passé" (5). La modernité aurait introduit l’émergence d’un sujet
mobile, contrastant avec la permanence de la maison. Cette question de
la possibilité de l’habiter avait été posée par Heidegger : l’homme
moderne n’habite plus car il souffre d’un "oubli du sens de l’être".
"Il semble que si la philosophie fait si souvent de l’architecture son
modèle, ce n’est pas seulement à partir de l’idée de système, de
construction fondée, c’est à partir de l’idée de demeure. Cela se
vérifie encore chez Heidegger, pour qui la pensée, dans le voisinage de
la poésie, est recueillement et abri de l’être, Heidegger qui désigne
la parole comme "maison de l’être" (6). Pourtant la maison comme "objet
phénoménal constant, isolé, immobile" est attaquée de toutes parts.
Pour Massimo Cacciari, la vie urbaine n’a plus rien à voir avec
l’habitation comme "wohnen", seule une architecture qui témoigne de
l’impossibilité de l’habiter peut encore avoir une certaine forme
d’authenticité, ainsi celle de Mies van der Rohe ("le langage de
l’absence témoigne ici de l’absence de l’habiter" écrit Cacciari).
Cette crise de l’habiter apparaîtra souvent dans l’art comme une crise
de la privacité. Ainsi, dans les vidéos de Tony Oursler, il est écrit
que "la seule façon de contrôler quoi que ce soit ici, ce serait de
quitter la maison" ; "la violence commence à la maison" (Private,
1993). La maison, quintessence du mythe de l’intérieur bourgeois, où
règnent le conventionnalisme, l’acceptation des valeurs, la répartition
homogène des rôles qui se dupliquent dans la vie sociale, est devenue
le lieu du conflit domestique, la scène émergente d’une crise de
l’identité. Violation / Transformation de Tony Oursler s’attaque de la
sorte au foyer monstrueux de cette déréliction : la télévision. La
"médiatisation" du sujet moderne aurait ainsi révélé la "violence du
domestique" (7) qui aurait à son tour provoqué l’extraction violente du
sujet hors de sa habitation. Quoi qu’il en soit, jamais la maison ne
sortira intacte de sa représentation : l’artiste s’en prendra non
seulement à son intégrité physique, mais une autre forme de violence se
fera jour : celle de la vision qui deviendra le paradigme d’une quête
impossible de l’habiter.
La maison : un reflet fracturé du miroir
Dans la littérature du XIXe siècle, la perception de la
maison est écartelée entre refuge et inquiétude. De la maison hantée du
romantisme gothique de Horace Walpole à celle, frémissant
d’"inquiétante étrangeté" (
 de Hoffmann, des ruines abandonnées de
de Hoffmann, des ruines abandonnées deVictor Hugo à l’effondrement de la maison Usher de Poe, du sublime de
William Burke, où la terreur est palpable jusque dans les recoins
obscurs de la maison, à l’Unheimlichkeit de Freud, de Walter Pater à
Walter Benjamin, le sujet se dédouble dans la terribilité de la maison.
Dans La Véranda de Herman Melville, la maison est devenue le sujet du
récit, construit entièrement sur un mécanisme de projection spéculaire.
La maison n’y relève que du registre du regard, jamais de l’habiter ;
le protagoniste se tient toujours à sa lisière, assis dans sa véranda,
d’où il contemple de l’autre côté de la colline les reflets d’une
maison idyllique au "pays des fées". La maison n’est plus inscription
dans un lieu défini, dans la durée du "demeurer", mais se projette dans
un ailleurs, au sein duquel le sujet se dédouble, propulsé hors de
lui-même, dans la quête de ce qui est inatteignable. Avant Melville, le
Landor’s Cottage d’Edgar Poe avait lui-aussi assimilé la maison à une
image de perfection absolue qui ne relevait que de l’ordre de la
vision : le cottage idyllique qui se détachait au milieu d’un paysage
incarnant la "perfection" n’est plus qu’une image, ultime garant du
bonheur, mais dont l’artificialité est le reflet de ce qui est
irrémédiablement perdu : l’habiter. Deux œuvres s’y réfèrent : la
maquette du "Landor’s Cottage" de Rodney Graham et "How to Remember a
better Tomorrow" d’Allen Ruppersberg, dont le titre repose sur une
temporalité contradictoire, "comment se souvenir d’un lendemain
meilleur". Dans l’œuvre de Ruppersberg, un cottage se détache au milieu
d’une pelouse verdoyante, parfaite incarnation de la vision stéréotypée
de la maison américaine. Une vidéo projetant des films publicitaires
des années 1950 vante le mode de vie familial idéal au sein du pavillon
américain. L’absence de foyer dans le cottage contraste avec la joyeuse
effervescence familiale des films qui apparaît comme un produit aussi
"préfabriqué" que le modèle standard de la maison. À nouveau la maison
n’est plus qu’illusion : la maquette parfaitement lissée du cottage,
qui fait écho aux images aseptisées des films promotionnels, émerge
d’une verdure taillée comme une reproduction. L’ensemble sécrète un
univers si idyllique qu’il en devient cauchemardesque et pose la
question : est-il encore possible d’habiter la maison ? La "vision" du
bonheur a ici pour unique ressort la déréalisation de l’habiter.
L’image de la maison générée par la maquette et celle du film
promotionnel se renvoient l’une à l’autre, comme à travers un miroir,
où s’efface la voix de l’habitant, où ne reste plus la maison que comme
simulacre d’un simulacre. L’objet originel nommé "maison" semble s’être
perdu dans les réflections d’une mise en abyme, dissocié en pure
phénoménalité, transformé en pur espace projectif "visionnaire".
Au début du XXe siècle, s’est opéré le passage d’une
modalité de vision à une autre. On pourrait avancer que si la camera
obscura peut se définir comme le modèle de vision du sujet du XIXe
siècle, ainsi que le suggère Jonathan Crary (9), elle s’identifierait
également au modèle de la maison, foyer obscur et impénétrable, au sein
duquel le sujet se dédouble et s’inverse (10). La modernité aurait
articulé le passage d’un modèle clos, projectif à travers le plan
d’interception du verre, en un modèle "transformatif", qu’explicitera
dans un autre registre Marcel Duchamp dans son Grand Verre (11) Cette
transition au cours de la modernité se signale dans un nouveau
dispositif de représentation de l’architecture où l’on passe du système
projectif de la perspective, auquel fait écho la camera obscura, à la
vue axonométrique, ainsi chez Theo van Doesburg dans le contexte du
néo-plasticisme. À l’inverse de la logique monoculaire qui impose un
sujet fixe, le sujet-observateur de la vue axonométrique surplombe un
espace découpé cliniquement dans lequel le bâtiment apparaît sans
fondations, flottant librement dans l’espace, à la manière de la
"Maison Domino" de Le Corbusier ou de la Maison Farnsworth de Mies van
der Rohe (12). À l’immobilisme du sujet, qui fixe un plan, a fait place
l’immersion du sujet au sein d’un espace-membrane ; au plan, s’est
substitué le volume, mais un volume qui spatialise la vision, la rend
extensible dans l’espace. Le passage de l’espace perspectiviste à
l’espace topologique de l’axonométrie au cours de la modernité est
aussi celui du sujet individué au sujet collectif, et peut-être la
transition de l’individuation de la maison à l’espace collectif de la
ville qui immerge le sujet.
Ce passage d’un mode de vision à un autre eut des
répercussions sur la politique de l’habiter, qui se manifeste également
à travers le bouleversement consécutif de la notion d’échelle. "Lorsque
la sculpture moderne passa de la représentation à l’abstraction, elle
passa de l’échelle spécifique à l’échelle non-spécifique. Lorsque la
sculpture cessa d’être anthropomorphique, alors son échelle cessa
d’être la dimension d’une représentation. L’architecture a toujours été
à l’échelle spécifique. L’échelle est l’axe crucial qui lie l’objet
architectural au sujet. Le modernisme exclura l’habitation de l’objet
réflexif". Jouer avec l’échelle de la maison dans l’art contemporain
sera une manière privilégiée de perturber son anthropomorphisme, son
individuation. En devenant "non-spécifique", l’échelle distendra
l’analogie entre la maison et le sujet qui l’habite. L’échelle fera
ainsi office de surface réfléchissante, comme les parois de verre
modernes, faisant refluer au dehors l’habitant. Échelle trop grande ou
trop étroite comme en témoigne la récurrence de l’objet maquette dans
l’art contemporain. La "Vanna Venturi House", à Chesnut Hill,
Philadelphia, en 1964, de Robert Venturi incarne bien cette prégnance
de l’échelle : cette petite maison utilise une échelle
disproportionnée, génératrice de la tension architecturale : "la façade
crée une image presque symbolique de la maison". Et Vanna Venturi, la
mère de l’architecte, s’y tient au dehors, pour la photographie, comme
refoulée par cette maison dont l’échelle ne correspond pas à la sienne,
qui a remplacé l’habiter par le dédoublement spéculaire de la maison en
façade, en signe, en échelle distendue, en mode scopique de vision.
L’immersion scopique du sujet
Si la maison se donne dans son altérité, on y pénètre
par le regard, par le fantasme. "La maison de Joséphine Baker" (1994)
de Dennis Adams est un aquarium dans lequel est plongée une maquette de
la maison à l’échelle 1 : 33. Cette maison avait été imaginée en 1928
pour Joséphine Baker par Adolf Loos, qui la conçut autour d’une piscine
sensée exalter le corps nu de Joséphine Baker. La fluidité de l’eau au
centre de l’architecture est le véritable occupant de la maison. Il
semblerait que cette maison n’ait d’ailleurs jamais été commandée par
Joséphine Baker, et ne soit qu’une pure émanation du désir de Loos. En
plongeant dans un réservoir d’eau la maquette de la maison, Dennis
Adams a rendu réversible ce regard de désir, jusque-là tourné vers
l’intérieur, vers l’apparition de Joséphine Baker au sommet des
escaliers menant à la piscine, où l’eau se réfracte dans la verrière.
"Hypnerotomachia" contemporaine, songe aquatique de Polyphile dans une
architecture fluidifiée en principe de désir, la maison projetée par
Loos évoque, pour Farès el-Dahdah (13), les dispositifs de désir, du
Petit Château de Choisy de Madame de Pompadour à la "petite maison" des
romans du XVIIIe siècle, comme ceux de Jean-François de Bastide, où la
maison était pensée comme machine de séduction. Chez Loos, les bandes
noires sur le marbre blanc renvoient, pour cet auteur, au corps rayé,
biffé de l’exotique Joséphine Baker, qui se répercute dans son
ineffable réflection dans l’eau et la lumière. Farès compare la maison
à un appareil photographique où l’idiosyncrasie de ses éléments
constitutifs obéit à un scénario voyeuriste. Au retrait de la féminité
qu’était le boudoir, fait place son immersion dans l’espace de la
maison à travers la piscine. Les miroirs d’eau et de lumière
transforment la privacité en spectacle : le corps s’expose, s’offre à
la vue dans la maison. D’habitation, la maison est devenue dispositif
de vision. L’invisible est devenu la réfraction haptique du visible où
le sujet devient un objet démultiplié dans son immersion scopique. La
maison comme mécanisme de vision et de désir fonctionne à travers
l’enjeu spéculaire du verre et de l’eau pour dissoudre le sujet privé
dans sa représentation à l’intérieur de l’espace privatif. La maison
serait ainsi ce modèle introverti, de plongée du sujet non pas dans son
intériorité, mais dans la réversion de son propre mode de vision (14).
![Composition visuelle [architecture] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: Composition visuelle [architecture]
Re: Composition visuelle [architecture]
Le sujet dissocié
Dan Graham fut un des rares artistes à problématiser le
rapport privé/public de la maison en torsadant ces deux termes en
miroir dans le dispositif même de ses œuvres. Dans le célèbre article
"Homes for America", publié en décembre 1966 dans la revue "Arts
Magazine" à New York, Dan Graham subvertissait tout à la fois
l’idéologie pop en intervenant dans le média lui-même, ainsi que la
logique minimaliste à travers la déclinaison sérielle de pavillons
standard de banlieue (tract housing). Il se jouait tout à la fois du
système préfabriqué de la maison et de celui du journal. "Homes for
America" associe texte et image, l’un et l’autre saisis dans leur
dimension ’documentaire’. Le cadrage des lotissements suburbains, qui
accentue leur uniformité, s’inscrivait également dans le sillage des
perspectives des maisons victoriennes, photographiées par Walker Evans
dans les années 1930, précurseur de l’objectivisme photographique que
développèrent Dan Graham aux Etats-Unis et les Becher en Allemagne dans
les années 1960. Dans la maquette Alteration to a Suburban House
(1978), Dan Graham a remplacé le mur extérieur du pavillon familial par
une cloison vitrée et placé au milieu de la maison un miroir de telle
sorte que le passant dans la rue soit non seulement impliqué dans
l’exposition d’une vie privée, mais s’y intègre physiquement à travers
le miroir, tandis que demeure invisible la seconde moitié de la maison
au-delà ce miroir. Absorption de l’extérieur, mise en exposition de
l’intérieur en même temps qu’occultation, Alteration entrave toute
dimension de l’habiter au profit d’une immersion de la vision dans
l’architecture privée qui en devient en quelque sorte l’occupant. Cette
œuvre de Dan Graham fait référence à l’architecture-signe, perméable à
son environnement médiatique de Robert Venturi, Michael Graves, Frank
O. Gehry, ainsi qu’aux maisons de verre de Mies van der Rohe et Philip
Johnson (New Canaan, 1949) (15). Elle opère la fusion de la maison de
verre et du pavillon typifié de banlieue. C’est à nouveau une logique
de renvoi spéculaire qui est à l’œuvre à travers le recours au verre et
au miroir qui s’efforce de rendre poreuses les limites
intérieur/extérieur, privé/public de la maison, de les torsader l’une
dans l’autre. Dan Graham rend compte ici de la privacité de la sphère
publique à laquelle répond la mise en publicité de la sphère privée, où
le "foyer" est devenu surface médiatique. L’architecture moderniste
avait rejeté cette spatialité, qui recueillait l’intériorité, pour
l’ouvrir sur l’extérieur, ou suspendre les fondations de la maison. La
situation de l’homme moderne est celle de l’individu qui "vient habiter
une maison où l’espace intérieur a été violenté et tourné vers le
dehors" (16).
De même, ici, chez Dan Graham, c’est le dehors qui a
investi le dedans, qui le scrute. Il n’y a plus d’antinomies, plus de
fondations, juste une impossibilité de l’habiter, devenue immersion
scopique du sujet, mais un sujet dissocié, pris en tenaille par, d’un
côté, son habitat exposé et de l’autre, occulté. La séparation du
miroir qui duplique l’espace intérieur ne peut incorporer l’autre
moitié occultée de la maison, en l’immergeant dans un processus de
vision. Dans Alteration, la subjectivité ne peut trouver refuge que
dans la partie occultée de la maison, devenue son "ça", sa dimension
irrationnelle, mais cette partie est devenue elle-aussi "inhabitable".
Aucune identité du sujet, dissocié entre son occultation et sa mise en
exposition, ne peut plus se constituer, l’identité étant elle-même
dédoublée dans un espace miroirique qui intègre l’"étranger" à la
maison, le passant qui se meut dans la rue. Nous sommes bien à l’apogée
d’une crise de l’habiter, d’une fracture irrémédiable dans l’analogie
séculaire entre l’objet maison et le sujet qui l’habite. L’un et
l’autre se sont démultipliés en instances oculaires qui les dépouillent
de toute corporéité. La maison est non seulement devenue une mise en
scène du regard dans la maison, mais a généré un sujet dissocié : le
"double" de l’habitant est devenu ce "passant" extérieur, ce
"wanderer", promeneur romantique qui, au début de la modernité, avait
déjà induit une crise de l’identité. Dédoublé en intérieur/extérieur,
l’occupant ne peut plus que tenter d’échafauder un autre "modèle", qui
échappe au trauma de l’inscription.
Dans Up to the Lintel (1992), Diana Thater projetait
des vidéos sur les fenêtres d’une maison de la banlieue de Pasadena, au
lieu même où elles avaient été tournées. "Les projections correspondent
à ce qu’un passant verrait depuis la rue dans la maison si celle-ci
était éclairée, une vue intérieure est interrompue par des barres
verticales". La maison n’est plus le domaine immanent de la conscience
comme le pensait Bachelard : la rue, la façade, les chambres de
projection sont devenues les seuls espaces occupables dans et autour de
la maison "illuminée". L’habitant est périphérique, elliptique,
maintenu au seuil de la maison.
Les maisons de la rue Sherbrooke, Montréal (1976) (16m4 x 15m8x12m,
commandé par The Arts and Culture Program of the XXI Olympiad) de
Melvin Charney est une œuvre spéculaire, bâtie à partir de
"l’image-miroir de deux édifices existant sur deux coins de rues
opposés". "J’ai bâti les figures d’un réel qui ne pouvait se valider
que dans sa réflection, dans un miroir" (17). Ces deux façades à
l’échelle réelle se trouvent à l’intersection de deux rues et rendent
visible les bâtiments qui y ont été détruits, exactement semblables aux
deux maisons de l’autre côté de la rue, dans un effet de dédoublement,
confrontant façades authentiques en pierre, et façades fictives en
contre-plaqué (18). La première photo représente le site originel, la
seconde, un montage et la troisième, l’installation, dont la dimension
scénographique suggérait un édifice inachevé ou en ruine, perturbant
son inscription temporelle, dans une conflagration du passé et du
présent à travers son effet-miroir. La ville de Montréal exigea que ces
architectures qui "portent les traces de leur propre destruction"
soient rapidement démontées. Lorsque Melvin Charney réalise A Toronto
Construction (1982), son œuvre s’inscrivit à nouveau dans un interstice
puisque les échafaudages prirent place sur un terrain vague entre deux
immeubles, redensifiant ce no man’s land. En reconstruisant l’identité
fictionnelle de maisons qui avaient disparu, Melvin Charney se heurta
aux oppositions de ses commanditaires. Les maisons ne peuvent en effet
prétendre annoncer leur ruine ou prédire leur déréliction. L’effet de
miroir entre réalité et fiction s’avéra polémique et déstabilisateur,
le factuel ne supportant pas sa propre projection.
Dans Splitting House (1974), Gordon Matta-Clark s’était
le premier attaqué à cette "violence du domestique", en sectionnant en
deux une maison de banlieue jusqu’à ses fondations ; les quatre angles
à l’intersection y furent enlevés ainsi que les matériaux de fondation,
provoquant l’inclinaison de la maison vers l’avant. "J’ai passé un jour
un magnifique après-midi avec Suzie Harris, à Green Camp. Nous avions
pris un tas de cailloux, et nous les avons disposés en une sorte de
terrasse grossière au milieu des bois ; cela nous a semblé comme le
premier acte d’une construction. Le premier acte, c’est le déplacement"
(19). Matta-Clark s’empare de la maison comme d’un matériau brut, sur
lequel il intervient à travers des prélèvements. Fendre une maison en
deux, la fissurer de lumière, équivaut à saper ses fondations, à lui
inoculer une dissociation fondamentale. Il s’agit également d’un "acte
de déplacement", d’une manière de "construire" à travers une opération
de soustraction, qui déplace le sens de la maison, le rend inopérant.
L’axe vertical qui définit habituellement la maison, de la cave au
grenier, s’est mué en rythme giratoire. L’élévation devient elliptique,
pivotant sur elle-même. Les deux moitiés séparées "se regardent" au
travers d’une fissure qui met en péril tout habitant. Le "sens" de la
maison est ici de se pencher vers la rue, de se mouvoir dans un lent
déplacement de ses fondations, - coupée en deux, dans une impossible
réconciliation de ses deux termes au croisement desquels s’inscrivait
l’habiter.
Cette illusion d’une unité de la maison sera également
mise à mal par Robert Gober dans Untitled (House) (1978-79) où la
maquette d’une maison coloniale néo-classique est fendue en deux, comme
sous le coup de l’antagonisme entre sécurité et conflit. "La maison
idéale implique la répression, la violence psychique, dirigée vers soi,
qui rend possible la vie de famille. La spatialisation de cette
répression est incarnée par la maison et, par extension, la communauté,
la ville, l’état" (20).. "Le domestique a toujours été en guerre. La
bataille de la famille, la bataille de la sexualité, la bataille pour
la propreté, pour l’hygiène" (21). "Plusieurs œuvres de Robert Gober du
début des années 1980 sont des maquettes de maisons qui reconstituent
minutieusement un intérieur domestique. Bien que cela ne soit jamais
précisé, la maison archétypale chez lui semble remonter aux années 1950
- les années d’enfance de Gober - qui coïncident avec la vague de
suburbanisation des Américains lorsque la maison unifamiliale émergea
comme symbole de la prospérité de l’après-guerre et de la liberté... Il
recréa cette scène de la maison... afin de faire apparaître la lacune
entre le désir de ce qui fut et le présent.... reconstructions
nostalgiques de fragments domestiques" (22). La maison serait la
"répression du désir et de la peur" qui peut conduire à l’étrangeté...
La maison et ses meubles deviennent des analogons du corps humain"
(23). Fendue en deux, la maison est habitée par un goufre, un
intervalle de vide, qui disloque la symétrie du fronton et des
colonnades. L’accident, la faille, la fissure est inoculée à la maison,
impuissante à reconstituer un sujet unitaire.
C’est précisément la dimension paradigmatique de la
maison qui est attaquée par ces œuvres où la logique spéculaire de la
maison, sensée nous renvoyer notre propre image, est exacerbée, jusqu’à
la rupture, à travers un processus physique chez Matta-Clark où la
maison, fendue en deux, se penche vers un impossible reflet, où gît le
sujet dissocié de l’habiter. De même, "La Casa" (1993) de Bernhard
Rüdiger et Liliana Moro est un toit coupé en deux, dont les versants
ont été retournés dans des sens opposés, afin de mettre en tension la
directionnalité du passage qu’ils ménagent. Le visiteur est
physiquement pris en tenaille par les deux pans de ce toit qui
dissocient littéralement son corps. À nouveau, la maison n’est pas un
espace à habiter ; au contraire, elle provoque une expérience tout à la
fois de claustrophobie, de réclusion, et de scission. "La Casa" est une
maison fendue en deux dont les versants se refléteraient de part et
d’autre d’un miroir invisible. La maison est une scène qui nous
regarde ; son dispositif est optique, et refoule le visiteur. La maison
n’est plus un analogon, mais un objet réflexif dissociatif. À la
modalité de l’habiter, a fait place un mode de vision où reflet,
dédoublement, immersion, entraînent la fragmentation du corps,
convergeant vers une dimension fractionnaire de l’espace, dont on ne se
demande plus s’il pourrait être encore habitable puisque l’habiter est
devenu un mode de vision, - celui du détachement du sujet de son
inscription.
Dan Graham fut un des rares artistes à problématiser le
rapport privé/public de la maison en torsadant ces deux termes en
miroir dans le dispositif même de ses œuvres. Dans le célèbre article
"Homes for America", publié en décembre 1966 dans la revue "Arts
Magazine" à New York, Dan Graham subvertissait tout à la fois
l’idéologie pop en intervenant dans le média lui-même, ainsi que la
logique minimaliste à travers la déclinaison sérielle de pavillons
standard de banlieue (tract housing). Il se jouait tout à la fois du
système préfabriqué de la maison et de celui du journal. "Homes for
America" associe texte et image, l’un et l’autre saisis dans leur
dimension ’documentaire’. Le cadrage des lotissements suburbains, qui
accentue leur uniformité, s’inscrivait également dans le sillage des
perspectives des maisons victoriennes, photographiées par Walker Evans
dans les années 1930, précurseur de l’objectivisme photographique que
développèrent Dan Graham aux Etats-Unis et les Becher en Allemagne dans
les années 1960. Dans la maquette Alteration to a Suburban House
(1978), Dan Graham a remplacé le mur extérieur du pavillon familial par
une cloison vitrée et placé au milieu de la maison un miroir de telle
sorte que le passant dans la rue soit non seulement impliqué dans
l’exposition d’une vie privée, mais s’y intègre physiquement à travers
le miroir, tandis que demeure invisible la seconde moitié de la maison
au-delà ce miroir. Absorption de l’extérieur, mise en exposition de
l’intérieur en même temps qu’occultation, Alteration entrave toute
dimension de l’habiter au profit d’une immersion de la vision dans
l’architecture privée qui en devient en quelque sorte l’occupant. Cette
œuvre de Dan Graham fait référence à l’architecture-signe, perméable à
son environnement médiatique de Robert Venturi, Michael Graves, Frank
O. Gehry, ainsi qu’aux maisons de verre de Mies van der Rohe et Philip
Johnson (New Canaan, 1949) (15). Elle opère la fusion de la maison de
verre et du pavillon typifié de banlieue. C’est à nouveau une logique
de renvoi spéculaire qui est à l’œuvre à travers le recours au verre et
au miroir qui s’efforce de rendre poreuses les limites
intérieur/extérieur, privé/public de la maison, de les torsader l’une
dans l’autre. Dan Graham rend compte ici de la privacité de la sphère
publique à laquelle répond la mise en publicité de la sphère privée, où
le "foyer" est devenu surface médiatique. L’architecture moderniste
avait rejeté cette spatialité, qui recueillait l’intériorité, pour
l’ouvrir sur l’extérieur, ou suspendre les fondations de la maison. La
situation de l’homme moderne est celle de l’individu qui "vient habiter
une maison où l’espace intérieur a été violenté et tourné vers le
dehors" (16).
De même, ici, chez Dan Graham, c’est le dehors qui a
investi le dedans, qui le scrute. Il n’y a plus d’antinomies, plus de
fondations, juste une impossibilité de l’habiter, devenue immersion
scopique du sujet, mais un sujet dissocié, pris en tenaille par, d’un
côté, son habitat exposé et de l’autre, occulté. La séparation du
miroir qui duplique l’espace intérieur ne peut incorporer l’autre
moitié occultée de la maison, en l’immergeant dans un processus de
vision. Dans Alteration, la subjectivité ne peut trouver refuge que
dans la partie occultée de la maison, devenue son "ça", sa dimension
irrationnelle, mais cette partie est devenue elle-aussi "inhabitable".
Aucune identité du sujet, dissocié entre son occultation et sa mise en
exposition, ne peut plus se constituer, l’identité étant elle-même
dédoublée dans un espace miroirique qui intègre l’"étranger" à la
maison, le passant qui se meut dans la rue. Nous sommes bien à l’apogée
d’une crise de l’habiter, d’une fracture irrémédiable dans l’analogie
séculaire entre l’objet maison et le sujet qui l’habite. L’un et
l’autre se sont démultipliés en instances oculaires qui les dépouillent
de toute corporéité. La maison est non seulement devenue une mise en
scène du regard dans la maison, mais a généré un sujet dissocié : le
"double" de l’habitant est devenu ce "passant" extérieur, ce
"wanderer", promeneur romantique qui, au début de la modernité, avait
déjà induit une crise de l’identité. Dédoublé en intérieur/extérieur,
l’occupant ne peut plus que tenter d’échafauder un autre "modèle", qui
échappe au trauma de l’inscription.
Dans Up to the Lintel (1992), Diana Thater projetait
des vidéos sur les fenêtres d’une maison de la banlieue de Pasadena, au
lieu même où elles avaient été tournées. "Les projections correspondent
à ce qu’un passant verrait depuis la rue dans la maison si celle-ci
était éclairée, une vue intérieure est interrompue par des barres
verticales". La maison n’est plus le domaine immanent de la conscience
comme le pensait Bachelard : la rue, la façade, les chambres de
projection sont devenues les seuls espaces occupables dans et autour de
la maison "illuminée". L’habitant est périphérique, elliptique,
maintenu au seuil de la maison.
Les maisons de la rue Sherbrooke, Montréal (1976) (16m4 x 15m8x12m,
commandé par The Arts and Culture Program of the XXI Olympiad) de
Melvin Charney est une œuvre spéculaire, bâtie à partir de
"l’image-miroir de deux édifices existant sur deux coins de rues
opposés". "J’ai bâti les figures d’un réel qui ne pouvait se valider
que dans sa réflection, dans un miroir" (17). Ces deux façades à
l’échelle réelle se trouvent à l’intersection de deux rues et rendent
visible les bâtiments qui y ont été détruits, exactement semblables aux
deux maisons de l’autre côté de la rue, dans un effet de dédoublement,
confrontant façades authentiques en pierre, et façades fictives en
contre-plaqué (18). La première photo représente le site originel, la
seconde, un montage et la troisième, l’installation, dont la dimension
scénographique suggérait un édifice inachevé ou en ruine, perturbant
son inscription temporelle, dans une conflagration du passé et du
présent à travers son effet-miroir. La ville de Montréal exigea que ces
architectures qui "portent les traces de leur propre destruction"
soient rapidement démontées. Lorsque Melvin Charney réalise A Toronto
Construction (1982), son œuvre s’inscrivit à nouveau dans un interstice
puisque les échafaudages prirent place sur un terrain vague entre deux
immeubles, redensifiant ce no man’s land. En reconstruisant l’identité
fictionnelle de maisons qui avaient disparu, Melvin Charney se heurta
aux oppositions de ses commanditaires. Les maisons ne peuvent en effet
prétendre annoncer leur ruine ou prédire leur déréliction. L’effet de
miroir entre réalité et fiction s’avéra polémique et déstabilisateur,
le factuel ne supportant pas sa propre projection.
Dans Splitting House (1974), Gordon Matta-Clark s’était
le premier attaqué à cette "violence du domestique", en sectionnant en
deux une maison de banlieue jusqu’à ses fondations ; les quatre angles
à l’intersection y furent enlevés ainsi que les matériaux de fondation,
provoquant l’inclinaison de la maison vers l’avant. "J’ai passé un jour
un magnifique après-midi avec Suzie Harris, à Green Camp. Nous avions
pris un tas de cailloux, et nous les avons disposés en une sorte de
terrasse grossière au milieu des bois ; cela nous a semblé comme le
premier acte d’une construction. Le premier acte, c’est le déplacement"
(19). Matta-Clark s’empare de la maison comme d’un matériau brut, sur
lequel il intervient à travers des prélèvements. Fendre une maison en
deux, la fissurer de lumière, équivaut à saper ses fondations, à lui
inoculer une dissociation fondamentale. Il s’agit également d’un "acte
de déplacement", d’une manière de "construire" à travers une opération
de soustraction, qui déplace le sens de la maison, le rend inopérant.
L’axe vertical qui définit habituellement la maison, de la cave au
grenier, s’est mué en rythme giratoire. L’élévation devient elliptique,
pivotant sur elle-même. Les deux moitiés séparées "se regardent" au
travers d’une fissure qui met en péril tout habitant. Le "sens" de la
maison est ici de se pencher vers la rue, de se mouvoir dans un lent
déplacement de ses fondations, - coupée en deux, dans une impossible
réconciliation de ses deux termes au croisement desquels s’inscrivait
l’habiter.
Cette illusion d’une unité de la maison sera également
mise à mal par Robert Gober dans Untitled (House) (1978-79) où la
maquette d’une maison coloniale néo-classique est fendue en deux, comme
sous le coup de l’antagonisme entre sécurité et conflit. "La maison
idéale implique la répression, la violence psychique, dirigée vers soi,
qui rend possible la vie de famille. La spatialisation de cette
répression est incarnée par la maison et, par extension, la communauté,
la ville, l’état" (20).. "Le domestique a toujours été en guerre. La
bataille de la famille, la bataille de la sexualité, la bataille pour
la propreté, pour l’hygiène" (21). "Plusieurs œuvres de Robert Gober du
début des années 1980 sont des maquettes de maisons qui reconstituent
minutieusement un intérieur domestique. Bien que cela ne soit jamais
précisé, la maison archétypale chez lui semble remonter aux années 1950
- les années d’enfance de Gober - qui coïncident avec la vague de
suburbanisation des Américains lorsque la maison unifamiliale émergea
comme symbole de la prospérité de l’après-guerre et de la liberté... Il
recréa cette scène de la maison... afin de faire apparaître la lacune
entre le désir de ce qui fut et le présent.... reconstructions
nostalgiques de fragments domestiques" (22). La maison serait la
"répression du désir et de la peur" qui peut conduire à l’étrangeté...
La maison et ses meubles deviennent des analogons du corps humain"
(23). Fendue en deux, la maison est habitée par un goufre, un
intervalle de vide, qui disloque la symétrie du fronton et des
colonnades. L’accident, la faille, la fissure est inoculée à la maison,
impuissante à reconstituer un sujet unitaire.
C’est précisément la dimension paradigmatique de la
maison qui est attaquée par ces œuvres où la logique spéculaire de la
maison, sensée nous renvoyer notre propre image, est exacerbée, jusqu’à
la rupture, à travers un processus physique chez Matta-Clark où la
maison, fendue en deux, se penche vers un impossible reflet, où gît le
sujet dissocié de l’habiter. De même, "La Casa" (1993) de Bernhard
Rüdiger et Liliana Moro est un toit coupé en deux, dont les versants
ont été retournés dans des sens opposés, afin de mettre en tension la
directionnalité du passage qu’ils ménagent. Le visiteur est
physiquement pris en tenaille par les deux pans de ce toit qui
dissocient littéralement son corps. À nouveau, la maison n’est pas un
espace à habiter ; au contraire, elle provoque une expérience tout à la
fois de claustrophobie, de réclusion, et de scission. "La Casa" est une
maison fendue en deux dont les versants se refléteraient de part et
d’autre d’un miroir invisible. La maison est une scène qui nous
regarde ; son dispositif est optique, et refoule le visiteur. La maison
n’est plus un analogon, mais un objet réflexif dissociatif. À la
modalité de l’habiter, a fait place un mode de vision où reflet,
dédoublement, immersion, entraînent la fragmentation du corps,
convergeant vers une dimension fractionnaire de l’espace, dont on ne se
demande plus s’il pourrait être encore habitable puisque l’habiter est
devenu un mode de vision, - celui du détachement du sujet de son
inscription.
![Composition visuelle [architecture] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: Composition visuelle [architecture]
Re: Composition visuelle [architecture]
Une maison modèle
S’"il n’y a pas de lieu comparable à la maison"
("There is no place like home", Dorothy, The Wizard of Oz), il semble
qu’il soit aujourd’hui difficile d’y prendre place "en paix" comme le
pensait encore Bachelard : entrer dans la maison signifie se confronter
à une crise identitaire du sujet. Lorsqu’elle n’est pas déstabilisée
dans ses fondations, la maison est soumise à un processus de réduction
de ses éléments constitutifs, qui aboutira à la maison typifiée en
maquette, ou à des variantes d’habitat où le toit, et son équivalent
nomade, la tente, délimiteront un espace hermétique à l’habiter. La
récurrence du toit est un signe de déhiscence de la maison, réduite à
un corps ouvert sans organes, dont ne subsiste plus qu’un cadre, telle
une tectonique vide et spectrale, détachée de tout ancrage.
Le toit
"Picoti, picota,
Qui picore mon petit toit ?"
Les enfants répondirent :
"C’est le vent, le vent,
le céleste enfant".
Les Frères Grimm, "Hänsel et Gretel".
Dans une mouvance post-minimale, nombreux furent les
artistes à élaguer la maison de tout superflu pour ne conserver que son
principal élément identificatoire : le toit à double pente. L’on peut
ici traverser les années 1980 et confronter un même modèle de maison,
une même maison modèle : les volumes minimaux de Joël Shapiro, les
maisons en béton d’Hubert Kiecol ou de Melvin Charney, les maisons de
Georg Ettl, d’Ettore Spalletti, de Louise Bourgeois, de Timm Ulrichs,
de David Rabinovitch, ou de Wolfgang Laib, en pollen ou en riz, sont
toutes des maisons où l’épure de leur volume découpe les murs d’une
maison réduite à son signe minimal, le toit. Les façades le plus
souvent aveugles font de la maison un bloc monolithique,
stéréométrique, clos sur lui-même, soumis à un rythme répétitif qui le
dépouille de toute individualité. La maison serait le paradigme d’une
perte de l’identité. Ses éléments structurels les plus significatifs
tels que le toit ont perdu de leur efficace architectonique, pour
s’abstraire en découpe ornementale agrémentant une forme cubique. Dans
les maisons renversées, sens dessus dessous, de Richard Wilson
("Lodger", 1981), à l’échelle humaine, la maison qui repose sur la
pointe de son toit véhicule un autre paradigme de cette perte de
l’habiter. "Pièce de monnaie" (1992) d’Hermann Pitz est un monolithe de
bois, recouvert d’anciens billets de banque qui forment le revêtement
nostalgique de cette maison avec toit et cheminée. En 1983,
"Glass-House" de Ludger Gerdes, dans le contexte de l’école de
Düsseldorf, est un toit qui repose sur quatre verres retournés, faisant
office à la fois de murs et de fenêtres. Cette maison de verre, qui
fragilise l’édifice moderniste, s’inscrit dans la fluidité des espaces
et l’ambivalence des éléments, où un objet domestique a soulevé la
maison de ses fondations : tout se passe comme si les fondations de la
maison s’étaient inversées dans le toit. Émancipé de toute appartenance
au sol, le toit est d’ailleurs le seul élément subsistant de "La maison
immatérielle" d’Yves Klein : "Un seul et unique toit d’air avec
soufflerie et aspiration à l’extrémité pour récupération et sections
d’airs pour limiter en espaces sous ce toit immense". Rattaché à
l’aérien, détaché de l’inscription, le toit deviendra paradigmatique de
la maison. Dans le sillage de Mary Miss et de Gordon Matta-Clark,"Low
Building with Dirt Roof for Mary" (1973) en Pennsylvanie, d’Alice
Aycock, était une maison à l’échelle réelle, si proche du sol qu’on ne
pouvait y entrer. La maison enfouie ne laisse saillir que son toit qui
a perdu sa fonction d’abri, pour flotter comme une barque retournée
dans l’espace.
"Aujourd’hui, en maints endroits, les maisons semblent prêtes pour le départ" (Bloch, 346)
La tente serait la version nomade du toit. Une des
premières tentes est "aérienne" : lors de l’exposition "Loucht Show" en
1968, en Italie, Marinus Boezem installe des ventilateurs qui soulèvent
une tente ; il crée également une "tente olfactive" contenant des
disques de naphtaline en évaporation. En mars 1969, l’artiste povera,
Emilio Prini, dresse une tente en dehors du musée lors de l’exposition
"Op Losse Schroeven" au Stedelijk Museum à Amsterdam (24). En 1973,
"I’m still a Young Man" (1973) du canadien Robin Collyer est une tente
d’enfant, montée dans une exposition. En 1975, Alan Saret, dans
"Ghosthouse", imagine une tente aux éléments flexibles, dont les formes
évoquent l’architecture organique de Bruno Taut et le biomorphisme de
Hermann Finsterlin. Dès 1969, Cildo Mereiles déclarait : "Nulle part
est ma maison" ; "Olvido" (1987-89) est une tente indigène dont
l’intérieur, peint en noir, est recouvert de billets des régions
américaines où vivent les Indiens. La tente se dresse au milieu d’une
aire circulaire d’ossements, entourée d’un mur en cire, tandis que de
l’intérieur de la tente, sourd le bruit d’une scie électrique. Au début
des années 1990, Lucy Orta confectionne des tentes-habitacles vêtements
(25). Loin du primitivisme de la hutte rustique, et d’une volonté de
retour à d’improbables origines, la tente, habitat provisoire et
démontable, transforme la maison en "nulle part", empêche son
immobilisation dans l’espace, mais aussi dans le temps. La "tente" de
Martin Honert est ainsi la maquette d’une tente qui puise dans
l’univers-refuge de l’enfance. Non-architecture par excellence, la
tente naît d’un seul geste, et se donne comme la maison "portative" que
l’on emporte avec soi, à l’instar de la dimension du souvenir. La
maison n’est plus qu’un épiderme détaché du corps de son habitant qui
se pose, mais ne s’inscrit pas.
La maison-modèle : un camouflage du sujet mimétique ?
"Sur le penchant de quelque agréable
colline bien ombragée, j’aurais une petite maison rustique, une maison
blanche avec des contrevents verts".
Jean-Jacques Rousseau, "Emilie".
La maison-maquette est sans doute l’élément le plus
récurrent dans l’art contemporain, univers en réduction, monde
miniature qui suscite des expériences projectives à travers le
dédoublement (cf. maquettes de Dennis Adams, Ruppersberg, etc.). La
maison semble être devenue une nouvelle apologie de la représentation
mimétique du sujet, un nouveau type de "portrait", où se retrouvent les
polarités de l’abstrait et du figuratif. Le sujet absent aurait ainsi
trouvé une nouvelle forme d’incarnation, de "reconstruction" à travers
la représentation de la maison où il met en scène sa propre
déréliction. Deux démarches se confrontent dans la maison-maquette : la
maison typifiée (versant "abstrait" du portrait), soumise à la
réduction formelle de ses éléments, qui se répètent le plus souvent en
autant de modules identiques, où le toit se donne comme l’ultime signe
de reconnaissance, et la maison-objet standard (versant "figuratif")
dont s’empare l’artiste. À l’opposé de la maison-bloc minimal, la
maison-standard développe une surchage identificatoire, accumulant
délibérément les stéréotypes, soumise à un processus de
sur-individuation. C’est la maquette de la maison typiquement
allemande, qui semble presque sortie d’une photographie de Thomas Ruff,
de Martin Honert ; le "cottage" de Rodney Graham, inspiré de la
nouvelle de Poe, maison de campagne idyllique ; la maison suburbaine de
Dan Graham ; la maison de l’américain moyen d’Allan Wexler ou encore
d’Ericson & Ziegler. Ces maquettes de maison sécrètent un univers
illusionnel, ou plutôt, désillusionnel, véhiculant le plus souvent une
expérience négative de l’habiter. La maison "minimale" est l’épure
géométrique qui nous renvoie à l’archétype "maison" comme structure
primaire ; le motif s’y abstrait dans une nouvelle forme de spatialité
close sur ses propres constituants ; différemment, la maison
"figurative" nous renvoie à une modalité mimétique de l’habiter, où la
maison est contextualisée, rapportée à une vie potentielle, un
voisinage, soumise à un dispositif de subjectivation de ses éléments.
Cette polarité est significative, et toujours récurrente (26).
Le "Denkmodell" : une maison publique
C’est au début des années 1980 que se développent les
premiers "modèles architectoniques" à travers l’école de Düsseldorf et
des artistes tels que Reinhard Mucha, Ludger Gerdes, Thomas Schütte,
Harald Klingelhöller, Wolfgang Luy, ou Klaus Jung. En réaction aux
mythologies alors très fortes de l’expressivité, l’architecture sera
appréhendée comme le médium d’un art collectif, où la maison
participera d’une tentative de réhabilitation de l’art "public". La
maquette d’architecture est, pour Ludger Gerdes, un "modèle à penser".
Il écrit à ce sujet : "Le mot "modèle" possède entre autres les deux
significations suivantes : 1) un modèle est ce qui sert d’objet
d’imitation pour créer quelque chose (modèle au sens de maquette), 2)
un modèle est la représentation des fonctions d’un objet ou d’une
situation (...) Schütte montre (à l’aide du modèle) quel rôle l’art est
capable de jouer dans le monde" (27). "Bau-Bild Krefeld" (1984),
littéralement "construction d’image", de Ludger Gerdes est à ce titre
l’une de ses œuvres les plus significatives, basée sur le plan des deux
maisons construites par Mies van der Rohe à Krefeld, combiné à un
collage de citations architecturales (arcades mauresques, etc), ainsi
que de reproductions miniatures de tableaux, qui transforment l’espace
en scène théâtrale, en "theatrum mundi". La maison est devenue la scène
post-moderne d’un sujet disséminé dans ses modes hétérogènes de
représentation, qui n’est plus au "centre" de la maison, mais se donne
sous la forme d’un corps discursif fragmenté qui ne fait qu’occuper des
strates partielles et intriquées d’habiter. Le "denkmodell" a une
portée épistémologique, menant vers une compréhension syncrétique des
arts dans le sillage du romantisme allemand. Cependant, aujourd’hui,
plus aucune unité du sujet ne peut être recomposée, comme en témoigne
la dislocation de son plus fidèle reflet mimétique, la maison. À ce
titre, "Haus Eck" (1985) de Gerdes n’est ni une sculpture ni une
maquette d’architecture, pourtant on y retrouve la typologie propre à
la maison : portes, fenêtres, plancher, mais désarticulés dans leur
relation fonctionnelle, qui délimitent un espace ouvert, pouvant tout
aussi bien signifier un espace intérieur qu’une place publique,
entourée d’habitations. Le sujet absent n’est ni dedans ni dehors : il
se tient désormais dans l’indécidable interface qu’est devenue la
maison.
Cette indétermination de l’espace privé/public dans les
œuvres de ces artistes de l’école de Düsseldorf est exemplifiée par les
"modèles" d’Harald Klingelhöller dont le travail sémantique sur le
langage ne conserve de la maison que ses éléments typologiques, tels
les syntagmes d’un espace, dont l’enchaînement aboutit à des "maisons".
Les titres de ses œuvres décrivent de manière réflexive une image
particulière de convention linguistique, sous-jacente à l’autonomie de
la structure formelle. Dans "La maison est inviolable", il s’avère
impossible d’individuer les éléments étant donné que ceux-ci ne se
donnent que dans leur chaînage linguistique, où le motif va acquérir
une dimension structurelle et diachronique. La "maison" de
Klingelhöller articule ainsi des éléments tectoniques dépourvus de
fonction, qui deviennent des ornements, tout à la fois motif et
abstraction. L’architecture est ici soumise à un "décadrage" littéral
et systématique. Si l’architecture encadre et cadre l’espace (28),
ligaturant le cadre en façade, la façade s’est ici désunie, feuillettée
en différentes strates d’ornements. Les œuvres de Klingelhöller sont à
ce titre semblables à des éléments architectoniques restitués à leur
autonomie ornementale, qui ne recomposeront surtout pas une
intériorité, mais s’en prendront à la dimension archaïque de la maison,
reflet unitaire du sujet, en la désarticulant en unités minimales et
anti-narratives. De même, l’assemblage de planches de bois, que dressa
Wolfgang Luy dans son atelier en 1982, délimitant les contours d’une
"maison", était une autre forme de "cadre" désencadré, de maison
implosée dans ses constituants, dont l’espace intérieur était cisaillé
de toutes parts par le rythme échevelé des planches, torsadant
intérieur et extérieur, pour aboutir à un espace architectonique
fluide, procédant par propagation de vagues et ruptures de plans comme
le "clinamen" de Lucrèce, ouvrant la voie à un espace topologique où il
ne peut plus y avoir d’"inscription", donc plus de "maison". Pour les
artistes de Düsseldorf, le modèle architectonique fut une manière de
mettre en crise un espace individué, dans ses ramifications sociales et
culturelles, comme en témoignent les maquettes de Thomas Schütte, en
particulier celles de maisons d’artiste ("WAS", "ELSA", 1989).
L’univers autiste de ces maquettes dialogue avec la table sur laquelle
elles sont posées, unique lien entre l’artiste, - personnage absent,
mais que l’on sait "habiter" son architecture-monade -, et son contexte
social, la table fonctionnant allégoriquement comme une place publique.
La maison se présente en même temps comme une abstraction constructive,
une élision de l’habiter. Loin d’incarner l’arkhé, fondation du lien,
ou l’oikos, la maison est devenue un modèle autiste qui met en crise le
champ contextuel de l’art. Chez Thomas Schütte, les modèles posés sur
des tables flottent au-dessus d’un espace vide, constitutif de ces
maisons sans fondation ni intériorité, clôturées sur leur propre
absence. Aspirant à retrouver l’incarnation d’une nouvelle forme de
"sociabilité", au sens le plus large, d’un échange avec le champ
contextuel et public de l’art, ces artistes eurent recours à la
représentation de la maison pour mieux mettre en crise le sujet, sous
la forme éclectique d’un Gerdes, sémantique d’un Klingelhöller ou d’un
Luy, voire même schizophrénique chez Schütte, afin de s’opposer de
toutes leurs forces à l’apologie substantialiste de la peinture
expressionniste qui leur était contemporaine et qui promouvait un
retour désespéré au signe identitaire, à la corporéité salvatrice.
Retour qui allait aussi rapidement s’échapper du support de la peinture
pour investir le domaine en apparence désubjectivisé de l’architecture
à travers le champ individué de la maison : dès lors, les multiples
déclinaisons de "maisons" dans l’art des années 1980-90, sous couvert
d’un conceptualisme ou d’un minimalisme de vocabulaire, se donneront
très souvent comme les sécrétions d’un sujet autiste, tourné vers sa
propre célébration. La maison refondra un sujet "héroïque" dans son
désespoir.
S’"il n’y a pas de lieu comparable à la maison"
("There is no place like home", Dorothy, The Wizard of Oz), il semble
qu’il soit aujourd’hui difficile d’y prendre place "en paix" comme le
pensait encore Bachelard : entrer dans la maison signifie se confronter
à une crise identitaire du sujet. Lorsqu’elle n’est pas déstabilisée
dans ses fondations, la maison est soumise à un processus de réduction
de ses éléments constitutifs, qui aboutira à la maison typifiée en
maquette, ou à des variantes d’habitat où le toit, et son équivalent
nomade, la tente, délimiteront un espace hermétique à l’habiter. La
récurrence du toit est un signe de déhiscence de la maison, réduite à
un corps ouvert sans organes, dont ne subsiste plus qu’un cadre, telle
une tectonique vide et spectrale, détachée de tout ancrage.
Le toit
"Picoti, picota,
Qui picore mon petit toit ?"
Les enfants répondirent :
"C’est le vent, le vent,
le céleste enfant".
Les Frères Grimm, "Hänsel et Gretel".
Dans une mouvance post-minimale, nombreux furent les
artistes à élaguer la maison de tout superflu pour ne conserver que son
principal élément identificatoire : le toit à double pente. L’on peut
ici traverser les années 1980 et confronter un même modèle de maison,
une même maison modèle : les volumes minimaux de Joël Shapiro, les
maisons en béton d’Hubert Kiecol ou de Melvin Charney, les maisons de
Georg Ettl, d’Ettore Spalletti, de Louise Bourgeois, de Timm Ulrichs,
de David Rabinovitch, ou de Wolfgang Laib, en pollen ou en riz, sont
toutes des maisons où l’épure de leur volume découpe les murs d’une
maison réduite à son signe minimal, le toit. Les façades le plus
souvent aveugles font de la maison un bloc monolithique,
stéréométrique, clos sur lui-même, soumis à un rythme répétitif qui le
dépouille de toute individualité. La maison serait le paradigme d’une
perte de l’identité. Ses éléments structurels les plus significatifs
tels que le toit ont perdu de leur efficace architectonique, pour
s’abstraire en découpe ornementale agrémentant une forme cubique. Dans
les maisons renversées, sens dessus dessous, de Richard Wilson
("Lodger", 1981), à l’échelle humaine, la maison qui repose sur la
pointe de son toit véhicule un autre paradigme de cette perte de
l’habiter. "Pièce de monnaie" (1992) d’Hermann Pitz est un monolithe de
bois, recouvert d’anciens billets de banque qui forment le revêtement
nostalgique de cette maison avec toit et cheminée. En 1983,
"Glass-House" de Ludger Gerdes, dans le contexte de l’école de
Düsseldorf, est un toit qui repose sur quatre verres retournés, faisant
office à la fois de murs et de fenêtres. Cette maison de verre, qui
fragilise l’édifice moderniste, s’inscrit dans la fluidité des espaces
et l’ambivalence des éléments, où un objet domestique a soulevé la
maison de ses fondations : tout se passe comme si les fondations de la
maison s’étaient inversées dans le toit. Émancipé de toute appartenance
au sol, le toit est d’ailleurs le seul élément subsistant de "La maison
immatérielle" d’Yves Klein : "Un seul et unique toit d’air avec
soufflerie et aspiration à l’extrémité pour récupération et sections
d’airs pour limiter en espaces sous ce toit immense". Rattaché à
l’aérien, détaché de l’inscription, le toit deviendra paradigmatique de
la maison. Dans le sillage de Mary Miss et de Gordon Matta-Clark,"Low
Building with Dirt Roof for Mary" (1973) en Pennsylvanie, d’Alice
Aycock, était une maison à l’échelle réelle, si proche du sol qu’on ne
pouvait y entrer. La maison enfouie ne laisse saillir que son toit qui
a perdu sa fonction d’abri, pour flotter comme une barque retournée
dans l’espace.
"Aujourd’hui, en maints endroits, les maisons semblent prêtes pour le départ" (Bloch, 346)
La tente serait la version nomade du toit. Une des
premières tentes est "aérienne" : lors de l’exposition "Loucht Show" en
1968, en Italie, Marinus Boezem installe des ventilateurs qui soulèvent
une tente ; il crée également une "tente olfactive" contenant des
disques de naphtaline en évaporation. En mars 1969, l’artiste povera,
Emilio Prini, dresse une tente en dehors du musée lors de l’exposition
"Op Losse Schroeven" au Stedelijk Museum à Amsterdam (24). En 1973,
"I’m still a Young Man" (1973) du canadien Robin Collyer est une tente
d’enfant, montée dans une exposition. En 1975, Alan Saret, dans
"Ghosthouse", imagine une tente aux éléments flexibles, dont les formes
évoquent l’architecture organique de Bruno Taut et le biomorphisme de
Hermann Finsterlin. Dès 1969, Cildo Mereiles déclarait : "Nulle part
est ma maison" ; "Olvido" (1987-89) est une tente indigène dont
l’intérieur, peint en noir, est recouvert de billets des régions
américaines où vivent les Indiens. La tente se dresse au milieu d’une
aire circulaire d’ossements, entourée d’un mur en cire, tandis que de
l’intérieur de la tente, sourd le bruit d’une scie électrique. Au début
des années 1990, Lucy Orta confectionne des tentes-habitacles vêtements
(25). Loin du primitivisme de la hutte rustique, et d’une volonté de
retour à d’improbables origines, la tente, habitat provisoire et
démontable, transforme la maison en "nulle part", empêche son
immobilisation dans l’espace, mais aussi dans le temps. La "tente" de
Martin Honert est ainsi la maquette d’une tente qui puise dans
l’univers-refuge de l’enfance. Non-architecture par excellence, la
tente naît d’un seul geste, et se donne comme la maison "portative" que
l’on emporte avec soi, à l’instar de la dimension du souvenir. La
maison n’est plus qu’un épiderme détaché du corps de son habitant qui
se pose, mais ne s’inscrit pas.
La maison-modèle : un camouflage du sujet mimétique ?
"Sur le penchant de quelque agréable
colline bien ombragée, j’aurais une petite maison rustique, une maison
blanche avec des contrevents verts".
Jean-Jacques Rousseau, "Emilie".
La maison-maquette est sans doute l’élément le plus
récurrent dans l’art contemporain, univers en réduction, monde
miniature qui suscite des expériences projectives à travers le
dédoublement (cf. maquettes de Dennis Adams, Ruppersberg, etc.). La
maison semble être devenue une nouvelle apologie de la représentation
mimétique du sujet, un nouveau type de "portrait", où se retrouvent les
polarités de l’abstrait et du figuratif. Le sujet absent aurait ainsi
trouvé une nouvelle forme d’incarnation, de "reconstruction" à travers
la représentation de la maison où il met en scène sa propre
déréliction. Deux démarches se confrontent dans la maison-maquette : la
maison typifiée (versant "abstrait" du portrait), soumise à la
réduction formelle de ses éléments, qui se répètent le plus souvent en
autant de modules identiques, où le toit se donne comme l’ultime signe
de reconnaissance, et la maison-objet standard (versant "figuratif")
dont s’empare l’artiste. À l’opposé de la maison-bloc minimal, la
maison-standard développe une surchage identificatoire, accumulant
délibérément les stéréotypes, soumise à un processus de
sur-individuation. C’est la maquette de la maison typiquement
allemande, qui semble presque sortie d’une photographie de Thomas Ruff,
de Martin Honert ; le "cottage" de Rodney Graham, inspiré de la
nouvelle de Poe, maison de campagne idyllique ; la maison suburbaine de
Dan Graham ; la maison de l’américain moyen d’Allan Wexler ou encore
d’Ericson & Ziegler. Ces maquettes de maison sécrètent un univers
illusionnel, ou plutôt, désillusionnel, véhiculant le plus souvent une
expérience négative de l’habiter. La maison "minimale" est l’épure
géométrique qui nous renvoie à l’archétype "maison" comme structure
primaire ; le motif s’y abstrait dans une nouvelle forme de spatialité
close sur ses propres constituants ; différemment, la maison
"figurative" nous renvoie à une modalité mimétique de l’habiter, où la
maison est contextualisée, rapportée à une vie potentielle, un
voisinage, soumise à un dispositif de subjectivation de ses éléments.
Cette polarité est significative, et toujours récurrente (26).
Le "Denkmodell" : une maison publique
C’est au début des années 1980 que se développent les
premiers "modèles architectoniques" à travers l’école de Düsseldorf et
des artistes tels que Reinhard Mucha, Ludger Gerdes, Thomas Schütte,
Harald Klingelhöller, Wolfgang Luy, ou Klaus Jung. En réaction aux
mythologies alors très fortes de l’expressivité, l’architecture sera
appréhendée comme le médium d’un art collectif, où la maison
participera d’une tentative de réhabilitation de l’art "public". La
maquette d’architecture est, pour Ludger Gerdes, un "modèle à penser".
Il écrit à ce sujet : "Le mot "modèle" possède entre autres les deux
significations suivantes : 1) un modèle est ce qui sert d’objet
d’imitation pour créer quelque chose (modèle au sens de maquette), 2)
un modèle est la représentation des fonctions d’un objet ou d’une
situation (...) Schütte montre (à l’aide du modèle) quel rôle l’art est
capable de jouer dans le monde" (27). "Bau-Bild Krefeld" (1984),
littéralement "construction d’image", de Ludger Gerdes est à ce titre
l’une de ses œuvres les plus significatives, basée sur le plan des deux
maisons construites par Mies van der Rohe à Krefeld, combiné à un
collage de citations architecturales (arcades mauresques, etc), ainsi
que de reproductions miniatures de tableaux, qui transforment l’espace
en scène théâtrale, en "theatrum mundi". La maison est devenue la scène
post-moderne d’un sujet disséminé dans ses modes hétérogènes de
représentation, qui n’est plus au "centre" de la maison, mais se donne
sous la forme d’un corps discursif fragmenté qui ne fait qu’occuper des
strates partielles et intriquées d’habiter. Le "denkmodell" a une
portée épistémologique, menant vers une compréhension syncrétique des
arts dans le sillage du romantisme allemand. Cependant, aujourd’hui,
plus aucune unité du sujet ne peut être recomposée, comme en témoigne
la dislocation de son plus fidèle reflet mimétique, la maison. À ce
titre, "Haus Eck" (1985) de Gerdes n’est ni une sculpture ni une
maquette d’architecture, pourtant on y retrouve la typologie propre à
la maison : portes, fenêtres, plancher, mais désarticulés dans leur
relation fonctionnelle, qui délimitent un espace ouvert, pouvant tout
aussi bien signifier un espace intérieur qu’une place publique,
entourée d’habitations. Le sujet absent n’est ni dedans ni dehors : il
se tient désormais dans l’indécidable interface qu’est devenue la
maison.
Cette indétermination de l’espace privé/public dans les
œuvres de ces artistes de l’école de Düsseldorf est exemplifiée par les
"modèles" d’Harald Klingelhöller dont le travail sémantique sur le
langage ne conserve de la maison que ses éléments typologiques, tels
les syntagmes d’un espace, dont l’enchaînement aboutit à des "maisons".
Les titres de ses œuvres décrivent de manière réflexive une image
particulière de convention linguistique, sous-jacente à l’autonomie de
la structure formelle. Dans "La maison est inviolable", il s’avère
impossible d’individuer les éléments étant donné que ceux-ci ne se
donnent que dans leur chaînage linguistique, où le motif va acquérir
une dimension structurelle et diachronique. La "maison" de
Klingelhöller articule ainsi des éléments tectoniques dépourvus de
fonction, qui deviennent des ornements, tout à la fois motif et
abstraction. L’architecture est ici soumise à un "décadrage" littéral
et systématique. Si l’architecture encadre et cadre l’espace (28),
ligaturant le cadre en façade, la façade s’est ici désunie, feuillettée
en différentes strates d’ornements. Les œuvres de Klingelhöller sont à
ce titre semblables à des éléments architectoniques restitués à leur
autonomie ornementale, qui ne recomposeront surtout pas une
intériorité, mais s’en prendront à la dimension archaïque de la maison,
reflet unitaire du sujet, en la désarticulant en unités minimales et
anti-narratives. De même, l’assemblage de planches de bois, que dressa
Wolfgang Luy dans son atelier en 1982, délimitant les contours d’une
"maison", était une autre forme de "cadre" désencadré, de maison
implosée dans ses constituants, dont l’espace intérieur était cisaillé
de toutes parts par le rythme échevelé des planches, torsadant
intérieur et extérieur, pour aboutir à un espace architectonique
fluide, procédant par propagation de vagues et ruptures de plans comme
le "clinamen" de Lucrèce, ouvrant la voie à un espace topologique où il
ne peut plus y avoir d’"inscription", donc plus de "maison". Pour les
artistes de Düsseldorf, le modèle architectonique fut une manière de
mettre en crise un espace individué, dans ses ramifications sociales et
culturelles, comme en témoignent les maquettes de Thomas Schütte, en
particulier celles de maisons d’artiste ("WAS", "ELSA", 1989).
L’univers autiste de ces maquettes dialogue avec la table sur laquelle
elles sont posées, unique lien entre l’artiste, - personnage absent,
mais que l’on sait "habiter" son architecture-monade -, et son contexte
social, la table fonctionnant allégoriquement comme une place publique.
La maison se présente en même temps comme une abstraction constructive,
une élision de l’habiter. Loin d’incarner l’arkhé, fondation du lien,
ou l’oikos, la maison est devenue un modèle autiste qui met en crise le
champ contextuel de l’art. Chez Thomas Schütte, les modèles posés sur
des tables flottent au-dessus d’un espace vide, constitutif de ces
maisons sans fondation ni intériorité, clôturées sur leur propre
absence. Aspirant à retrouver l’incarnation d’une nouvelle forme de
"sociabilité", au sens le plus large, d’un échange avec le champ
contextuel et public de l’art, ces artistes eurent recours à la
représentation de la maison pour mieux mettre en crise le sujet, sous
la forme éclectique d’un Gerdes, sémantique d’un Klingelhöller ou d’un
Luy, voire même schizophrénique chez Schütte, afin de s’opposer de
toutes leurs forces à l’apologie substantialiste de la peinture
expressionniste qui leur était contemporaine et qui promouvait un
retour désespéré au signe identitaire, à la corporéité salvatrice.
Retour qui allait aussi rapidement s’échapper du support de la peinture
pour investir le domaine en apparence désubjectivisé de l’architecture
à travers le champ individué de la maison : dès lors, les multiples
déclinaisons de "maisons" dans l’art des années 1980-90, sous couvert
d’un conceptualisme ou d’un minimalisme de vocabulaire, se donneront
très souvent comme les sécrétions d’un sujet autiste, tourné vers sa
propre célébration. La maison refondra un sujet "héroïque" dans son
désespoir.
![Composition visuelle [architecture] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: Composition visuelle [architecture]
Re: Composition visuelle [architecture]
La maison-portrait
Si le sujet était mis en crise dans les "modèles" des
artistes de l’école de Düsseldorf, les maisons-maquettes vont, dans la
plupart des cas, valider un retour au subjectivisme. La maison va se
donner sous une forme narrative intériorisée, fonctionnant à la manière
d’un "portrait". Ici la maison est tout à la fois le "modèle" et sa
représentation, le "portrait". Si la maison remplace le visage (comme
dans des dessins de Louise Bourgeois ou dans un photomontage d’Henri
Jacobs, ou encore dans les œuvres de Thierry de Cordier où la maison
est corps), ce n’est pas la métaphore de la "maison-cerveau" qui est à
l’œuvre, mais la propagation métonymique du fonctionnement mimétique
entre maison et portrait. La maison est à ce point le "modèle" (donc
l’habitant) et le "portrait" que la présence de l’habitant ne peut être
que redondante. C’est le cas des maquettes d’appartement que Michael
Hurson réalise dans les années 1970 ("Thurman Buzzard’s Apartment",
1973-74) où les pièces sont pour lui, non pas le contenant de "drames",
mais sont en elles-mêmes des "drames" inachevés, des représentations
théâtrales dépouillées d’acteurs, comme dans les scénographies vides
d’Adolphe Appia au début du siècle où l’architecture même est le drame.
Le personnage fictif est ici l’appartement et ses traces. Cette
dimension de la maison comme équivalent architectonique de la forme de
représentation mimétique qu’est le portrait se retrouve dans les
maisons-maquettes de Mark Manders ("Autoportrait comme construction",
1986), ou encore dans les trois maquettes de maisons de Walter Dahn,
portrait "musical" de l’Amérique des années 1960 avec "Elvis Presley’s
Birthplace in Tupelo", "The House of the Blues", tirée de la couverture
d’un album de John Lee Hooker et "Gilded Palace of Sin" (1995),
inspirée de l’album éponyme de Flying Burrito Brothers. La volonté de
précision dans le détail renvoie à des modèles eux-mêmes fictifs de
maison, détachés de tout référent réel. La maison est ici le "portrait"
du rêve de l’américain moyen du "middle-west", marqué par la culture
musicale du blues et du rock d’Elvis Presley. Ces maisons américaines,
témoins d’une certaine époque, ne se veulent pas des "maquettes", mais
des "reconstructions" du passé sous la forme du "bricolage" qui
préserve leur statut précaire de signe temporel, "maisons décrites
d’avance comme des souvenirs" (Marc Augé). De même, les maisons de
Donna Dennis, qui découlent dès la fin des années 1960 de la rédaction
d’un journal intime ("Excerpts from Journal", 1969), témoignent de
cette dimension paradigmatique du "portrait" individuel, signes
d’isolement et de solitude comme dans les peintures d’Edward Hopper qui
inspirèrent cette artiste américaine (29). "Je ferai des maisons
solitaires, des pièges en réalité... une maison qui ne soit pas une
maison. Une maison en voyage. Une maison, un abri, mais sans chaleur,
confort et sécurité. Un "lieu où se trouver" seulement pour une nuit,
avant de partir et ne jamais rester longtemps quelque part... Le
confort ne se trouve que dans le déplacement" (D. Dennis, 1971). Ses
"maisons" s’inspirent de motels, de stations de métros, d’abris
provisoires, et appellent le spectateur à se transformer en voyeur pour
regarder au travers de leurs fenêtres. À petite échelle ou à l’échelle
humaine, ces maisons se donnent comme des décors de théâtre, ou des
motifs picturaux transposés dans l’architecture. La maison est
métaphoriquement le sujet, l’habitant, le dépositaire de son "histoire"
qui se rassemble dans un seul lieu où l’architecture privée devient le
porte-parole presque nécrologique du sujet qui, lui, n’est plus visible.
Pour Manfredo Tafuri, depuis Boullée et Ledoux au
XVIIIe siècle, l’architecture est devenue une forme individuelle qui a
perdu sa connexion à la ville. Que la maison apparaisse très souvent
dans l’art contemporain comme une maison singulière, isolée dans un
espace et temps subjectifs, lui a permis de rejoindre la dimension du
portrait, dans sa composante individuée ou générique (maison-typifiée).
Alberti avait déclaré : "La maison est une petite ville, et la ville,
une grande maison". Le Città (1994) de Liliana Moro brisent à ce titre
l’isolement de la maison en la transformant en "ville" : des petites
maquettes de maisons en papier, jouets pour enfant, truffées de fils
électriques où des ampoules s’allument par intermittence, tissent un
espace connectif, social, urbain. Les "guirlandes" lumineuses éclairent
l’intérieur de ces maisons, comme un signe de fête. Leur éclairage qui
advient brusquement évoque la "stupeur" benjaminienne, le choc qui nous
arrache à l’habitude, et nous fait apparaître les choses comme pour la
première fois. Le jouet, la maison-maquette illuminée, qui reconduit le
temps immanent du réel dans son apparaître, s’oppose à la déréalisation
de l’architecture que la perte d’échelle a réduit à n’être plus qu’un
objet de "dérision" au sens philosophique. Les maisons sont sans
intériorité, nœud de propagation des circuits électriques, foyer
médiatique de la maison moderne qui n’est plus qu’une enveloppe sans
contenu. L’on n’habite plus dans ces maisons, qui sont devenues des
"villes", parce que la circulation l’a emporté sur l’inscription. Ce
sont ici les fils électriques qui assurent la connexion, et développent
une forme de narrativité dans l’œuvre de Liliana Moro, qui affranchit
de son repli la maison, pour la transformer en portrait collectif et
interactif.
Détruire la maison
Quelle est cette maison si "modèle" pour que l’on
veuille à ce point la détruire, l’endommager, s’en prendre à son
intégrité physique et presque "morale" ? Retournerait-on à une approche
organique, évolutive de la maison, qui devrait connaître la même
déréliction temporelle que le sujet ? Au début des années 1970, Robert
Smithson définit la maison comme "entropique" à travers la notion de
"ruins in reverse", "ruines à l’envers" ("A Tour of the Monuments of
Passaic, New Jersey"). À l’opposé de la "ruine romantique", les
monuments entropiques tombent en ruine avant même d’être construits. Le
temps linéaire y implose. "Partially Buried Woodshed" ("Baraque en bois
partiellement enterrée", 1970) est une baraque sur laquelle un
bulldozer déverse de la terre jusqu’à son effondrement. "Island of the
Dismantled Building, Vancouver" (1970) nous montre la démolition de ce
qui est déjà une ruine, ou encore, "Hotel Palenque" (1969-72) incarne
l’effondrement de la matière et de l’esprit dans cette "maison Usher"
post-industrielle. Dans tous les cas, le processus de destruction est
advenu avant même qu’il se soit manifesté comme tel ; la maison
court-circuite le temps, il n’y a plus ici d’édification, d’extraction
hors de la matière informe, mais un processus d’ensevelissement où la
réversion des procédures fait retourner le sujet et la maison à
l’"informe" à l’instar de la matière. Les "ruines" de Smithson sont un
remblayage du temps : un futur antérieur qui a rattrapé ces maisons,
rongées par l’entropie.
L’échelle pourrait être une des principales symboliques
à l’œuvre dans la maison : l’on y monte ou descend, de la cave au
grenier, l’on s’arrête à ses étagements, comme à autant de paliers ou
d’étapes dans l’égrenage du temps. L’échelle nous inscrit également
dans un ordre téléologique des choses, dans un mouvement de quête ou
d’ascension. À l’inverse, dans l’art contemporain, la maison est le
plus souvent ramenée à un étage unique, à une horizontalisation où il
n’y a plus d’accès vers des strates différenciées les unes des autres.
Chez Robert Smithson, l’échelle s’est inexorablement écroulée, les
strates se confondent en sédiments mêlés. De même qu’une carte
géographique, déchirée en morceaux, est jetée sur une terre craquelée,
au début du film "Spiral Jetty", l’architecture s’est désintégrée, et
plus jamais la maison ne pourra émerger de ses ruines parce qu’elle ne
peut se référer qu’à cet ordre de l’informe, à l’effondrement de
l’échelle.
La destruction de la maison résulte cependant le plus
souvent de son identification au corps humain, tous deux soumis à un
rythme de croissance organique et de déperdition. Alberti avait
identifié la maison au corps. Cette analogie anthropomorphique continue
de hanter les murs de la maison. Dans le dessin "La femme-maison" de
Louise Bourgeois en 1947, la maison s’est substituée au visage. "Les
maisons se ressemblent ou se distinguent les unes des autres comme les
corps humains" (30). Si la maison est la "métaphore du corps et du lien
social, la maison et son image sont aussi des métaphores du temps
humain" (31), par conséquent la maison pourra aussi être soumise au
processus de destruction du corps. Depuis les années 1960, Charles
Simonds est l’artiste qui opère la fusion entre l’architecture et le
corps, rendu à la terre matricielle, à travers ses architectures
d’argile réalisées à même son corps, ainsi "Paysage/ corps/ habitation"
en 1971, tout à la fois paysage et ville construits sur son propre
corps, et voués à la disparition. Dans un esprit bachelardien, Ira Joel
Haber réalise dans les années 1960-70 des boîtes dans le sillage
surréaliste, proche de Joseph Cornell et Max Ernst ("Box with Eight
Blue and White Houses", 1969). Ces boîtes abritent des maisons
désertes, rongées par la végétation, victimes de la nature, réceptacles
potentiels de drames psychologiques qui identifient la maison à un
corps en perdition (32). Dans un registre minimal, pour Pedro Cabrita
Reis, le corps est maison, toute construction est un corps, et
l’abstration géométrique de ses installations se donnera comme
l’extrapolation de cette spatialité. Basserode créa des maisons
cryptiques, en tourbe, végétaux, cire, charbon, ainsi la "maison de
mots" où, à l’intérieur de réceptacles cubiques de cire, des mots sont
enfermés dans des coquilles d’œufs. Le déroulement narratif dans le
temps est enseveli dans cette maison qui développe son propre cycle de
vie, dont les "habitants" sont la matière évolutive.
Dans "La poétique de l’espace", Bachelard écrivait :
"Si je devais indiquer le principal attrait d’une maison, je dirais que
la maison abrite le rêve éveillé, la maison protège le rêveur".
Pourtant la maison ne protège plus, elle est même attaquée dans son
intégrité physique : maison calcinée de Robert Gober ("Burnt House",
1980), maison en plâtre désagrégée d’Isa Genzken, effondrée de Didier
Marcel, maison en friandises putréfiées de Patrick van Caeckenbergh
("Hansel & Gretel", 1985). La maison n’abrite plus le rêve, mais le
cauchemar ; elle est devenue le lieu d’un traumatisme de l’habiter. La
série d’"Abandoned House" de Sam Durant, dans les années 1990, recourt
aux matériaux utilisés dans les habitations de banlieue (carton et
mousse), et retourne les notions de protection et de sécurité physique
de la maison en inquiétude et angoisse. Ses maquettes, disposées sur
des tables, sont les modèles de maisons familiales construites à Los
Angeles dans les années 1940-50. Ces maisons modernistes qui évoquent
l’idéal géométrique du Bauhaus furent précipitamment construites en
préfabriqué. Elles sont ici sujettes au délabrement, à la déréliction :
trouées dans les murs, poussière, ruines, etc. Tout n’est plus que
déclin ; le processus d’érosion du temps est rendu visible. La maison
américaine apparaît comme le lieu d’une déviance économique et morale,
lieu d’une entropie ou d’un danger qui ne peut être contrôlé. Sam
Durant fait ainsi se percuter dans le présent le"futur" traumatique de
la maison. Cette perte de sécurité et de rationalité se retrouve aussi
aux États-Unis dans certaines œuvres de Mike Kelley, Paul Mc Carthy, ou
Jason Rhoades.
Ailleurs la maison sera laissée dans un état
d’"inachèvement" : dans le contexte du pop art, Georges Segal érige un
mur de briques dont la construction inachevée nous laisse regarder à
l’intérieur d’une pièce, occupée par de fantômatiques habitants de
plâtre. Le temps y est suspendu dans l’absence d’avènement. En 1994,
l’artiste belge Ann Veronica Janssens érige une maison en briques,
recouvertes de papier aluminium, dont la construction s’est elle-aussi
interrompue, de telle sorte qu’intérieur et extérieur continuent de
communiquer, empêchant la maison de s’ériger en enceinte, repli d’un
noyau privatif. Dans les années 1980, Tony Cragg dresse des murs de
briques qui ne sont la résultante que d’un processus d’entassement. Il
n’y a plus ici de "lien" parce qu’il n’y a plus d’"acte de construire",
réduit à la "pose" d’éléments irrémédiablement dissociés entre eux.
Marcel Broodthaers avait appelé ironiquement, en 1967, "monument"
l’élévation d’une colonne de briques dans laquelle était restée
prisonnière une truelle : toute action est suspendue, différée, la
"construction" ne parvient à se finaliser en "image" de maison. La
destruction, la suspension dans le temps, l’indétermination entre passé
et futur, la conflagration du temps dans la construction déjà faite
ruine de Smithson, l’inachèvement de l’acte de construire, son
élémentarisation en éléments dissociés, ne parviennent plus à accomplir
la maison comme habitation. L’image même de la maison demeure vouée à
l’incomplétude. La maison n’est plus cette membrane qui enveloppe le
sujet, mais s’est interrompue à un moment de son processus. Cette
interruption va conforter la maison dans son statut d’"intervalle", et
anéantir tout lien ou fondation. Ce processus, arrêté ou accéléré,
transforme la maison en élément "archéologisé", acteur d’un futur
antérieur, d’une temporalité sans inscription fixe.
Si le sujet était mis en crise dans les "modèles" des
artistes de l’école de Düsseldorf, les maisons-maquettes vont, dans la
plupart des cas, valider un retour au subjectivisme. La maison va se
donner sous une forme narrative intériorisée, fonctionnant à la manière
d’un "portrait". Ici la maison est tout à la fois le "modèle" et sa
représentation, le "portrait". Si la maison remplace le visage (comme
dans des dessins de Louise Bourgeois ou dans un photomontage d’Henri
Jacobs, ou encore dans les œuvres de Thierry de Cordier où la maison
est corps), ce n’est pas la métaphore de la "maison-cerveau" qui est à
l’œuvre, mais la propagation métonymique du fonctionnement mimétique
entre maison et portrait. La maison est à ce point le "modèle" (donc
l’habitant) et le "portrait" que la présence de l’habitant ne peut être
que redondante. C’est le cas des maquettes d’appartement que Michael
Hurson réalise dans les années 1970 ("Thurman Buzzard’s Apartment",
1973-74) où les pièces sont pour lui, non pas le contenant de "drames",
mais sont en elles-mêmes des "drames" inachevés, des représentations
théâtrales dépouillées d’acteurs, comme dans les scénographies vides
d’Adolphe Appia au début du siècle où l’architecture même est le drame.
Le personnage fictif est ici l’appartement et ses traces. Cette
dimension de la maison comme équivalent architectonique de la forme de
représentation mimétique qu’est le portrait se retrouve dans les
maisons-maquettes de Mark Manders ("Autoportrait comme construction",
1986), ou encore dans les trois maquettes de maisons de Walter Dahn,
portrait "musical" de l’Amérique des années 1960 avec "Elvis Presley’s
Birthplace in Tupelo", "The House of the Blues", tirée de la couverture
d’un album de John Lee Hooker et "Gilded Palace of Sin" (1995),
inspirée de l’album éponyme de Flying Burrito Brothers. La volonté de
précision dans le détail renvoie à des modèles eux-mêmes fictifs de
maison, détachés de tout référent réel. La maison est ici le "portrait"
du rêve de l’américain moyen du "middle-west", marqué par la culture
musicale du blues et du rock d’Elvis Presley. Ces maisons américaines,
témoins d’une certaine époque, ne se veulent pas des "maquettes", mais
des "reconstructions" du passé sous la forme du "bricolage" qui
préserve leur statut précaire de signe temporel, "maisons décrites
d’avance comme des souvenirs" (Marc Augé). De même, les maisons de
Donna Dennis, qui découlent dès la fin des années 1960 de la rédaction
d’un journal intime ("Excerpts from Journal", 1969), témoignent de
cette dimension paradigmatique du "portrait" individuel, signes
d’isolement et de solitude comme dans les peintures d’Edward Hopper qui
inspirèrent cette artiste américaine (29). "Je ferai des maisons
solitaires, des pièges en réalité... une maison qui ne soit pas une
maison. Une maison en voyage. Une maison, un abri, mais sans chaleur,
confort et sécurité. Un "lieu où se trouver" seulement pour une nuit,
avant de partir et ne jamais rester longtemps quelque part... Le
confort ne se trouve que dans le déplacement" (D. Dennis, 1971). Ses
"maisons" s’inspirent de motels, de stations de métros, d’abris
provisoires, et appellent le spectateur à se transformer en voyeur pour
regarder au travers de leurs fenêtres. À petite échelle ou à l’échelle
humaine, ces maisons se donnent comme des décors de théâtre, ou des
motifs picturaux transposés dans l’architecture. La maison est
métaphoriquement le sujet, l’habitant, le dépositaire de son "histoire"
qui se rassemble dans un seul lieu où l’architecture privée devient le
porte-parole presque nécrologique du sujet qui, lui, n’est plus visible.
Pour Manfredo Tafuri, depuis Boullée et Ledoux au
XVIIIe siècle, l’architecture est devenue une forme individuelle qui a
perdu sa connexion à la ville. Que la maison apparaisse très souvent
dans l’art contemporain comme une maison singulière, isolée dans un
espace et temps subjectifs, lui a permis de rejoindre la dimension du
portrait, dans sa composante individuée ou générique (maison-typifiée).
Alberti avait déclaré : "La maison est une petite ville, et la ville,
une grande maison". Le Città (1994) de Liliana Moro brisent à ce titre
l’isolement de la maison en la transformant en "ville" : des petites
maquettes de maisons en papier, jouets pour enfant, truffées de fils
électriques où des ampoules s’allument par intermittence, tissent un
espace connectif, social, urbain. Les "guirlandes" lumineuses éclairent
l’intérieur de ces maisons, comme un signe de fête. Leur éclairage qui
advient brusquement évoque la "stupeur" benjaminienne, le choc qui nous
arrache à l’habitude, et nous fait apparaître les choses comme pour la
première fois. Le jouet, la maison-maquette illuminée, qui reconduit le
temps immanent du réel dans son apparaître, s’oppose à la déréalisation
de l’architecture que la perte d’échelle a réduit à n’être plus qu’un
objet de "dérision" au sens philosophique. Les maisons sont sans
intériorité, nœud de propagation des circuits électriques, foyer
médiatique de la maison moderne qui n’est plus qu’une enveloppe sans
contenu. L’on n’habite plus dans ces maisons, qui sont devenues des
"villes", parce que la circulation l’a emporté sur l’inscription. Ce
sont ici les fils électriques qui assurent la connexion, et développent
une forme de narrativité dans l’œuvre de Liliana Moro, qui affranchit
de son repli la maison, pour la transformer en portrait collectif et
interactif.
Détruire la maison
Quelle est cette maison si "modèle" pour que l’on
veuille à ce point la détruire, l’endommager, s’en prendre à son
intégrité physique et presque "morale" ? Retournerait-on à une approche
organique, évolutive de la maison, qui devrait connaître la même
déréliction temporelle que le sujet ? Au début des années 1970, Robert
Smithson définit la maison comme "entropique" à travers la notion de
"ruins in reverse", "ruines à l’envers" ("A Tour of the Monuments of
Passaic, New Jersey"). À l’opposé de la "ruine romantique", les
monuments entropiques tombent en ruine avant même d’être construits. Le
temps linéaire y implose. "Partially Buried Woodshed" ("Baraque en bois
partiellement enterrée", 1970) est une baraque sur laquelle un
bulldozer déverse de la terre jusqu’à son effondrement. "Island of the
Dismantled Building, Vancouver" (1970) nous montre la démolition de ce
qui est déjà une ruine, ou encore, "Hotel Palenque" (1969-72) incarne
l’effondrement de la matière et de l’esprit dans cette "maison Usher"
post-industrielle. Dans tous les cas, le processus de destruction est
advenu avant même qu’il se soit manifesté comme tel ; la maison
court-circuite le temps, il n’y a plus ici d’édification, d’extraction
hors de la matière informe, mais un processus d’ensevelissement où la
réversion des procédures fait retourner le sujet et la maison à
l’"informe" à l’instar de la matière. Les "ruines" de Smithson sont un
remblayage du temps : un futur antérieur qui a rattrapé ces maisons,
rongées par l’entropie.
L’échelle pourrait être une des principales symboliques
à l’œuvre dans la maison : l’on y monte ou descend, de la cave au
grenier, l’on s’arrête à ses étagements, comme à autant de paliers ou
d’étapes dans l’égrenage du temps. L’échelle nous inscrit également
dans un ordre téléologique des choses, dans un mouvement de quête ou
d’ascension. À l’inverse, dans l’art contemporain, la maison est le
plus souvent ramenée à un étage unique, à une horizontalisation où il
n’y a plus d’accès vers des strates différenciées les unes des autres.
Chez Robert Smithson, l’échelle s’est inexorablement écroulée, les
strates se confondent en sédiments mêlés. De même qu’une carte
géographique, déchirée en morceaux, est jetée sur une terre craquelée,
au début du film "Spiral Jetty", l’architecture s’est désintégrée, et
plus jamais la maison ne pourra émerger de ses ruines parce qu’elle ne
peut se référer qu’à cet ordre de l’informe, à l’effondrement de
l’échelle.
La destruction de la maison résulte cependant le plus
souvent de son identification au corps humain, tous deux soumis à un
rythme de croissance organique et de déperdition. Alberti avait
identifié la maison au corps. Cette analogie anthropomorphique continue
de hanter les murs de la maison. Dans le dessin "La femme-maison" de
Louise Bourgeois en 1947, la maison s’est substituée au visage. "Les
maisons se ressemblent ou se distinguent les unes des autres comme les
corps humains" (30). Si la maison est la "métaphore du corps et du lien
social, la maison et son image sont aussi des métaphores du temps
humain" (31), par conséquent la maison pourra aussi être soumise au
processus de destruction du corps. Depuis les années 1960, Charles
Simonds est l’artiste qui opère la fusion entre l’architecture et le
corps, rendu à la terre matricielle, à travers ses architectures
d’argile réalisées à même son corps, ainsi "Paysage/ corps/ habitation"
en 1971, tout à la fois paysage et ville construits sur son propre
corps, et voués à la disparition. Dans un esprit bachelardien, Ira Joel
Haber réalise dans les années 1960-70 des boîtes dans le sillage
surréaliste, proche de Joseph Cornell et Max Ernst ("Box with Eight
Blue and White Houses", 1969). Ces boîtes abritent des maisons
désertes, rongées par la végétation, victimes de la nature, réceptacles
potentiels de drames psychologiques qui identifient la maison à un
corps en perdition (32). Dans un registre minimal, pour Pedro Cabrita
Reis, le corps est maison, toute construction est un corps, et
l’abstration géométrique de ses installations se donnera comme
l’extrapolation de cette spatialité. Basserode créa des maisons
cryptiques, en tourbe, végétaux, cire, charbon, ainsi la "maison de
mots" où, à l’intérieur de réceptacles cubiques de cire, des mots sont
enfermés dans des coquilles d’œufs. Le déroulement narratif dans le
temps est enseveli dans cette maison qui développe son propre cycle de
vie, dont les "habitants" sont la matière évolutive.
Dans "La poétique de l’espace", Bachelard écrivait :
"Si je devais indiquer le principal attrait d’une maison, je dirais que
la maison abrite le rêve éveillé, la maison protège le rêveur".
Pourtant la maison ne protège plus, elle est même attaquée dans son
intégrité physique : maison calcinée de Robert Gober ("Burnt House",
1980), maison en plâtre désagrégée d’Isa Genzken, effondrée de Didier
Marcel, maison en friandises putréfiées de Patrick van Caeckenbergh
("Hansel & Gretel", 1985). La maison n’abrite plus le rêve, mais le
cauchemar ; elle est devenue le lieu d’un traumatisme de l’habiter. La
série d’"Abandoned House" de Sam Durant, dans les années 1990, recourt
aux matériaux utilisés dans les habitations de banlieue (carton et
mousse), et retourne les notions de protection et de sécurité physique
de la maison en inquiétude et angoisse. Ses maquettes, disposées sur
des tables, sont les modèles de maisons familiales construites à Los
Angeles dans les années 1940-50. Ces maisons modernistes qui évoquent
l’idéal géométrique du Bauhaus furent précipitamment construites en
préfabriqué. Elles sont ici sujettes au délabrement, à la déréliction :
trouées dans les murs, poussière, ruines, etc. Tout n’est plus que
déclin ; le processus d’érosion du temps est rendu visible. La maison
américaine apparaît comme le lieu d’une déviance économique et morale,
lieu d’une entropie ou d’un danger qui ne peut être contrôlé. Sam
Durant fait ainsi se percuter dans le présent le"futur" traumatique de
la maison. Cette perte de sécurité et de rationalité se retrouve aussi
aux États-Unis dans certaines œuvres de Mike Kelley, Paul Mc Carthy, ou
Jason Rhoades.
Ailleurs la maison sera laissée dans un état
d’"inachèvement" : dans le contexte du pop art, Georges Segal érige un
mur de briques dont la construction inachevée nous laisse regarder à
l’intérieur d’une pièce, occupée par de fantômatiques habitants de
plâtre. Le temps y est suspendu dans l’absence d’avènement. En 1994,
l’artiste belge Ann Veronica Janssens érige une maison en briques,
recouvertes de papier aluminium, dont la construction s’est elle-aussi
interrompue, de telle sorte qu’intérieur et extérieur continuent de
communiquer, empêchant la maison de s’ériger en enceinte, repli d’un
noyau privatif. Dans les années 1980, Tony Cragg dresse des murs de
briques qui ne sont la résultante que d’un processus d’entassement. Il
n’y a plus ici de "lien" parce qu’il n’y a plus d’"acte de construire",
réduit à la "pose" d’éléments irrémédiablement dissociés entre eux.
Marcel Broodthaers avait appelé ironiquement, en 1967, "monument"
l’élévation d’une colonne de briques dans laquelle était restée
prisonnière une truelle : toute action est suspendue, différée, la
"construction" ne parvient à se finaliser en "image" de maison. La
destruction, la suspension dans le temps, l’indétermination entre passé
et futur, la conflagration du temps dans la construction déjà faite
ruine de Smithson, l’inachèvement de l’acte de construire, son
élémentarisation en éléments dissociés, ne parviennent plus à accomplir
la maison comme habitation. L’image même de la maison demeure vouée à
l’incomplétude. La maison n’est plus cette membrane qui enveloppe le
sujet, mais s’est interrompue à un moment de son processus. Cette
interruption va conforter la maison dans son statut d’"intervalle", et
anéantir tout lien ou fondation. Ce processus, arrêté ou accéléré,
transforme la maison en élément "archéologisé", acteur d’un futur
antérieur, d’une temporalité sans inscription fixe.
![Composition visuelle [architecture] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: Composition visuelle [architecture]
Re: Composition visuelle [architecture]
L’incarcération du domestique
"Dans le futur, chaque maison sera comme une petite
forteresse. Dans le futur, chaque maison sera devenue un parc de
divertissement total". David Byrne, "In the future", 1984.
La première partie de cette citation pourrait
s’appliquer à la maison de Jean-Pierre Raynaud dont l’histoire commence
avec les "psycho-objets" en 1965, abris dans lesquel l’on peut entrer.
En 1968, il achète un terrain et à partir d’éléments standards dans un
catalogue, fait établir les plans d’une maison en longueur sur deux
niveaux, qui serait une "maison de tout le monde". Dès 1970,
apparaissent les premières modifications, parmi lesquelles le carrelage
de 15 cm sur 15 cm, serti d’un joint noir, en premier lieu dans la
salle de musique, avant d’envahir rapidement toute la maison,
homogénéisant l’espace qui se transformera en centre d’un
"psycho-drame". La maison porte déjà les premiers signes de cette
volonté d’enfermement qui aboutira au blockhaus. "L’idée essentielle
était de se protéger au maximum, de faire quelque chose où il n’y avait
pas à discuter avec le monde extérieur". "Si j’avais pu acheter un
sous-marin, je l’aurais recouvert de terre et j’y serais entré comme
dans une maison" écrivit J.-P. Raynaud. "La maison familiale
individuelle doit sa séduction toujours renouvelée au fait que ses
propriétaires peuvent la modifier ou la contrôler à leur guise, comme
une petite forteresse susceptible d’être aménagée sur mesure pour
devenir le support de n’importe quelle expression sociale" (33). Cette
volonté de protection du monde extérieur, de la maladie, de la mort,
aboutira à la destruction, après que la maison soit devenue tombeau,
cénotaphe, temple. Ici la maison est un corps, aux mues successives,
qui subit des transformations à la manière d’un organisme vivant. "La
maison porte les stigmates de ses luttes et se reconstruit sur
elle-même sans cesse" (34) ; "la maison n’est pas un objet. Elle est
espace et contenant d’objets, ayant, chacun, un rapport à l’espace. La
maison n’a pas de centre ; elle est polynucléaire, mais chaque lieu a
son rôle à jouer par rapport aux autres dans une structure organique"
(35). En 1974, Raynaud ouvre sa maison au public et en 1979, expose ses
"fragments archéologiques". En 1988, il décide de tout arrêter pour
vingt ans, la maison est détruite et revendue. La maison aura été pour
lui le lieu d’une expérimentation privilégiée de l’espace-temps, sans
cesse reconduite. Le chez-soi mortifère de Raynaud fait presque écho à
ce qu’avançait Ernst Bloch : "L’œuvre de désintériorisation ainsi
entamée devint création de vide" ; "la maison doit redevenir une
forteresse, quand ce n’est pas une catacombe" (36). Elle est soumise à
un cycle de construction/destruction qui arase toute mémoire possible
du lieu sans cesse transfiguré dans ses métamorphoses.
La réclusion, l’enfermement sédimente la vidéo de Bill
Viola, "Room for St John of the Cross" (1983), où l’artiste était resté
confiné dans une pièce, évoquant la cellule du mystique espagnol St
Jean de la Croix au XVIème siècle, emprisonné pendant neuf mois. La
maison se réduit à sa plus petite unité, la cellule de prison,
expérience d’une régression dans l’espace et le temps (37). En 1983,
"Reasons for Knocking at an Empty House" fut une tentative de rester
continuellement éveillé pendant trois jours, enfermé dans une pièce au
premier étage d’une maison vide. La maison est le lieu de
l’incarcération, de la mortification de soi. Bill Viola y tenta une
expérience dilatoire du temps, qui puisse devenir un temps sans
jointure, arraché au mondain. Qu’est-ce que signifie cependant une
maison vide ? Son dénuement renvoie à une absence, un vide narratif qui
exténue tout paradigme, où la maison génère une expérience de
dépropriation de soi, où aucun mécanisme d’identification, réconfort
des objets ou des individus, n’est possible. En 1994, Mario Airo dressa
dans une galerie à Milan "Unité d’habitation", en briques et tuiles,
qui reconstitue une cellule de moine du XIIIème siècle ; seuls les murs
sont visibles, et l’on ne voit l’intérieur que par une fenêtre depuis
la cour. La maison-cellule est devenue l’unité minimale de repli,
d’absentification dans laquelle le sujet est soumis à l’occultation et
à l’isolement radical.
La maison-empreinte
D’autres artistes ont exploité l’analogie entre la
maison et la dernière "demeure" qu’est la tombe. Wolfgang Laib
déclara : "Mes maisons ont la forme d’une maison, mais aussi d’une
tombe musulmane, ou d’un reliquaire médiéval, mais au lieu de contenir
des ossements de saints, elles contiennent de la nourriture". Dans
"Ghost", en 1990, Rachel Whiteread créa une sorte de maison-tombe,
frappée de mutisme, dans un processus de retournement de l’espace,
s’inspirant des maquettes en plâtre d’espaces intérieurs de
l’architecte Luigi Moretti dans les années 1950. Ici la "maison",
volume plein, est le moule, l’empreinte d’une pièce d’une maison
victorienne. Le vide est ainsi devenu le plein, le plus intime s’est
transformé en monumental. La maison ne résulte donc pas d’une
construction, d’un acte d’addition, mais d’un acte de soustraction,
d’une empreinte, objet moulé comme un masque de mort, portrait
mortuaire ou mémorial, qui fixe un espace négatif. L’empreinte est
devenue un modèle à l’échelle 1 : 1. Il est bien entendu impossible
d’entrer dans la maison, objet claustrophique inhabitable. "Ghost"
refuse l’illusion d’un retour à la maison. La maison-simulacre est
devenue une image de l’objet perdu. La maison comme "habitus", lieu des
habitudes dans l’habitation, n’est plus. Le processus du modelage
répète le jeu de la présence et de l’absence, le moule est jeté et, si
le moulage s’avère un supplément à l’original, l’original est l’espace,
un pur vide. Le moulage reste cependant un rappel constant de
l’intériorité, même si les portes ne s’ouvrent pas, et que les fenêtres
sont obstruées. La maison est devenue une surface impénétrable, qui
nous oppose sa résistance, son mutisme. Ces "maisons" de Whiteread
rendent compte d’une inversion métaphorique du corps, d’une réversion
de l’intériorité et de l’extériorité. "Ghost" est un corps incarcéré où
a disparu la dialectique des polarités cave/grenier,
rationnel/irrationnel, fondatrice de la maison. "La maison, comme
catégorie, est une région intermédiaire entre celle de l’individualité,
qu’elle soit aliénée ou intégrée, et la totalité socioarchitecturale",
"tout ce qui est utilisé comme maison devient une maison" (38) écrivait
Robert Kleyn : ce n’est pas l’acte de construire, mais l’acte de penser
la maison comme telle qui la définit à travers une procédure
d’instrumentalisation. Mais ici la maison n’est plus qu’une présence
spectrale, un objet "perdu".
Différemment, Pep Agut réalise des modèles de son
atelier, qui sont une sorte de négatif architectural de l’espace d’une
pièce réelle, où se recouvrent espace réel et représentationnel. Il
conçoit aussi des installations faites de murs de cotons, de toile et
de bois, appréhendées comme des "modèles de lumière" ("Exact Rooms",
1992 ; "Expulsion from Paradise", 1992). Au contraire des empreintes de
Rachel Whiteread, un espace positif s’élabore, où l’on peut prendre
place et circuler dans une "réplique" différée du cadre privatif. Dans
les constructions architecturales de Krijn de Koning, c’est la façade
qui invite à entrer ; plus que l’espace à traverser, il s’agit d’une
forme à saisir dans son ensemble. Ces installations témoignent d’un
passage de l’état de construction à celui de sculpture. La lumière sur
le blanc du plâtre donne à la forme sculpturale la possibilité de
s’abstraire de l’espace qui l’entoure tout en y faisant corps. Dans les
constructions de Laurent Pariente, un labyrinthe se trame, remettant en
question les modalités de l’espace intérieur : on entre par une porte,
on regarde comme à travers une fenêtre, on traverse un seuil : le corps
peut s’inscrire dans l’œuvre comme une empreinte dans l’espace négatif
d’une habitation qui ne recèle plus aucune intériorité, remplacée par
la dimension du passage, de la traversée des espaces.
"Dans le futur, chaque maison sera comme une petite
forteresse. Dans le futur, chaque maison sera devenue un parc de
divertissement total". David Byrne, "In the future", 1984.
La première partie de cette citation pourrait
s’appliquer à la maison de Jean-Pierre Raynaud dont l’histoire commence
avec les "psycho-objets" en 1965, abris dans lesquel l’on peut entrer.
En 1968, il achète un terrain et à partir d’éléments standards dans un
catalogue, fait établir les plans d’une maison en longueur sur deux
niveaux, qui serait une "maison de tout le monde". Dès 1970,
apparaissent les premières modifications, parmi lesquelles le carrelage
de 15 cm sur 15 cm, serti d’un joint noir, en premier lieu dans la
salle de musique, avant d’envahir rapidement toute la maison,
homogénéisant l’espace qui se transformera en centre d’un
"psycho-drame". La maison porte déjà les premiers signes de cette
volonté d’enfermement qui aboutira au blockhaus. "L’idée essentielle
était de se protéger au maximum, de faire quelque chose où il n’y avait
pas à discuter avec le monde extérieur". "Si j’avais pu acheter un
sous-marin, je l’aurais recouvert de terre et j’y serais entré comme
dans une maison" écrivit J.-P. Raynaud. "La maison familiale
individuelle doit sa séduction toujours renouvelée au fait que ses
propriétaires peuvent la modifier ou la contrôler à leur guise, comme
une petite forteresse susceptible d’être aménagée sur mesure pour
devenir le support de n’importe quelle expression sociale" (33). Cette
volonté de protection du monde extérieur, de la maladie, de la mort,
aboutira à la destruction, après que la maison soit devenue tombeau,
cénotaphe, temple. Ici la maison est un corps, aux mues successives,
qui subit des transformations à la manière d’un organisme vivant. "La
maison porte les stigmates de ses luttes et se reconstruit sur
elle-même sans cesse" (34) ; "la maison n’est pas un objet. Elle est
espace et contenant d’objets, ayant, chacun, un rapport à l’espace. La
maison n’a pas de centre ; elle est polynucléaire, mais chaque lieu a
son rôle à jouer par rapport aux autres dans une structure organique"
(35). En 1974, Raynaud ouvre sa maison au public et en 1979, expose ses
"fragments archéologiques". En 1988, il décide de tout arrêter pour
vingt ans, la maison est détruite et revendue. La maison aura été pour
lui le lieu d’une expérimentation privilégiée de l’espace-temps, sans
cesse reconduite. Le chez-soi mortifère de Raynaud fait presque écho à
ce qu’avançait Ernst Bloch : "L’œuvre de désintériorisation ainsi
entamée devint création de vide" ; "la maison doit redevenir une
forteresse, quand ce n’est pas une catacombe" (36). Elle est soumise à
un cycle de construction/destruction qui arase toute mémoire possible
du lieu sans cesse transfiguré dans ses métamorphoses.
La réclusion, l’enfermement sédimente la vidéo de Bill
Viola, "Room for St John of the Cross" (1983), où l’artiste était resté
confiné dans une pièce, évoquant la cellule du mystique espagnol St
Jean de la Croix au XVIème siècle, emprisonné pendant neuf mois. La
maison se réduit à sa plus petite unité, la cellule de prison,
expérience d’une régression dans l’espace et le temps (37). En 1983,
"Reasons for Knocking at an Empty House" fut une tentative de rester
continuellement éveillé pendant trois jours, enfermé dans une pièce au
premier étage d’une maison vide. La maison est le lieu de
l’incarcération, de la mortification de soi. Bill Viola y tenta une
expérience dilatoire du temps, qui puisse devenir un temps sans
jointure, arraché au mondain. Qu’est-ce que signifie cependant une
maison vide ? Son dénuement renvoie à une absence, un vide narratif qui
exténue tout paradigme, où la maison génère une expérience de
dépropriation de soi, où aucun mécanisme d’identification, réconfort
des objets ou des individus, n’est possible. En 1994, Mario Airo dressa
dans une galerie à Milan "Unité d’habitation", en briques et tuiles,
qui reconstitue une cellule de moine du XIIIème siècle ; seuls les murs
sont visibles, et l’on ne voit l’intérieur que par une fenêtre depuis
la cour. La maison-cellule est devenue l’unité minimale de repli,
d’absentification dans laquelle le sujet est soumis à l’occultation et
à l’isolement radical.
La maison-empreinte
D’autres artistes ont exploité l’analogie entre la
maison et la dernière "demeure" qu’est la tombe. Wolfgang Laib
déclara : "Mes maisons ont la forme d’une maison, mais aussi d’une
tombe musulmane, ou d’un reliquaire médiéval, mais au lieu de contenir
des ossements de saints, elles contiennent de la nourriture". Dans
"Ghost", en 1990, Rachel Whiteread créa une sorte de maison-tombe,
frappée de mutisme, dans un processus de retournement de l’espace,
s’inspirant des maquettes en plâtre d’espaces intérieurs de
l’architecte Luigi Moretti dans les années 1950. Ici la "maison",
volume plein, est le moule, l’empreinte d’une pièce d’une maison
victorienne. Le vide est ainsi devenu le plein, le plus intime s’est
transformé en monumental. La maison ne résulte donc pas d’une
construction, d’un acte d’addition, mais d’un acte de soustraction,
d’une empreinte, objet moulé comme un masque de mort, portrait
mortuaire ou mémorial, qui fixe un espace négatif. L’empreinte est
devenue un modèle à l’échelle 1 : 1. Il est bien entendu impossible
d’entrer dans la maison, objet claustrophique inhabitable. "Ghost"
refuse l’illusion d’un retour à la maison. La maison-simulacre est
devenue une image de l’objet perdu. La maison comme "habitus", lieu des
habitudes dans l’habitation, n’est plus. Le processus du modelage
répète le jeu de la présence et de l’absence, le moule est jeté et, si
le moulage s’avère un supplément à l’original, l’original est l’espace,
un pur vide. Le moulage reste cependant un rappel constant de
l’intériorité, même si les portes ne s’ouvrent pas, et que les fenêtres
sont obstruées. La maison est devenue une surface impénétrable, qui
nous oppose sa résistance, son mutisme. Ces "maisons" de Whiteread
rendent compte d’une inversion métaphorique du corps, d’une réversion
de l’intériorité et de l’extériorité. "Ghost" est un corps incarcéré où
a disparu la dialectique des polarités cave/grenier,
rationnel/irrationnel, fondatrice de la maison. "La maison, comme
catégorie, est une région intermédiaire entre celle de l’individualité,
qu’elle soit aliénée ou intégrée, et la totalité socioarchitecturale",
"tout ce qui est utilisé comme maison devient une maison" (38) écrivait
Robert Kleyn : ce n’est pas l’acte de construire, mais l’acte de penser
la maison comme telle qui la définit à travers une procédure
d’instrumentalisation. Mais ici la maison n’est plus qu’une présence
spectrale, un objet "perdu".
Différemment, Pep Agut réalise des modèles de son
atelier, qui sont une sorte de négatif architectural de l’espace d’une
pièce réelle, où se recouvrent espace réel et représentationnel. Il
conçoit aussi des installations faites de murs de cotons, de toile et
de bois, appréhendées comme des "modèles de lumière" ("Exact Rooms",
1992 ; "Expulsion from Paradise", 1992). Au contraire des empreintes de
Rachel Whiteread, un espace positif s’élabore, où l’on peut prendre
place et circuler dans une "réplique" différée du cadre privatif. Dans
les constructions architecturales de Krijn de Koning, c’est la façade
qui invite à entrer ; plus que l’espace à traverser, il s’agit d’une
forme à saisir dans son ensemble. Ces installations témoignent d’un
passage de l’état de construction à celui de sculpture. La lumière sur
le blanc du plâtre donne à la forme sculpturale la possibilité de
s’abstraire de l’espace qui l’entoure tout en y faisant corps. Dans les
constructions de Laurent Pariente, un labyrinthe se trame, remettant en
question les modalités de l’espace intérieur : on entre par une porte,
on regarde comme à travers une fenêtre, on traverse un seuil : le corps
peut s’inscrire dans l’œuvre comme une empreinte dans l’espace négatif
d’une habitation qui ne recèle plus aucune intériorité, remplacée par
la dimension du passage, de la traversée des espaces.
![Composition visuelle [architecture] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: Composition visuelle [architecture]
Re: Composition visuelle [architecture]
La maison-squelette
En 1976, à Philadelphia, l’architecte Robert Venturi
conçut un musée à la mémoire de Benjamin Franklin, à l’endroit même où
celui-ci avait fait bâtir sa propre maison, dont les plans exacts
étaient inconnus (Venturi, Scott Brown and Associates, Inc., Franklin
Court, Independance National Historical Park, Philadelphia). Venturi
construisit "une maison-fantôme, une œuvre conceptuelle" (Dan Graham),
évoquant tout à la fois les cubes de Sol LeWitt, le Bauhaus et
l’urbanisme moderniste, pour représenter la forme que pouvait avoir
cette maison à travers notre connaissance incomplète de celle-ci : un
cadre schématique en acier, simple structure linéaire, et deux formes
cubiques accrochées à l’arête du toit surmontée d’une cheminée,
suffirent à en rendre compte (39). L’espace d’exposition qui comprend
des objets ayant appartenu à la maison se trouve au sous-sol, où des
vitrines donnent aux visiteurs l’accès aux fouilles de la fondation,
aux restes archéologiques de la maison réduite à la présence spectrale
d’une structure en acier "fantômatique". Des citations de lettres
adressées par Franklin à sa femme au cours de la construction de cette
maison furent gravées dans le pavement, insufflant une dimension
narrative et un temps rétroactif à la grille immuable qui incarne
désormais cette maison, tandis que les cinq maisons historiques en face
de la maison Franklin furent reconstruites. Cette "ghost house" est
habitée par la perte et l’exhumation de cette perte, transformée en
image vouée à l’incomplétude dans sa forme et sa fonction. La maison
est un objet perdu, dont seule la grille, devenue la maison
anamorphosée, peut témoigner, parce que la grille n’abrite ni
n’occulte, mais se donne juste comme un seuil de translation de
l’espace et du temps, de déplacement de l’ancrage de la maison.
Dans les années 1990, de nombreux artistes
dépouillèrent la maison en "cadre" ou en grille architecturant
l’espace, ne conservant plus de la maison que ses "arêtes", ainsi la
série de maquettes réalisées par Jef Geys, où la maison s’inscrit entre
une abstraction constructiviste et un jeu de construction multipliant
les plans orthogonaux. La "Spin House" de Tony Brown se donne comme une
surface régulée de grilles qui laisse entrevoir un espace intérieur,
structure tout à la fois cloisonnée comme un espace carcéral ou une
cage, et ouverte en claire-voie. Après sa célèbre installation à la
Fondation Saatchi, où l’immensité d’une surface d’huile faisait se
réfléchir l’espace alentour, provoquant une perte d’orientation, mais
surtout architecturant l’espace uniquement à partir d’elle, l’artiste
anglais Richard Wilson réalisa en 1996 "Room 6, Channel View Hotel",
translation des volumes et des plans d’un appartement en lignes
tubulaires, reposant sur des roulettes. La maison se réduisait à la
représentation diagrammatique de ses différents espaces fonctionnels,
rendus mobiles, déplaçables. Permutant intérieur et extérieur, la
grille rend la maison à sa mobilité, assure à travers la translation
des espaces le déplacement de ses fondations. Si l’architecture se
réduit à un "emboîtement de formes cadrantes" (40), à une mise en abyme
d’elle-même, la grille en est devenue la quintessence ; désormais la
maison est un cadre démultiplié, mis en abyme, mais qui n’encadre plus
rien, sinon le vide. Ce cadre, qui s’est autonomisé en architecture,
n’ouvre plus comme une fenêtre sur quelque chose, parce qu’il n’y a
plus de foyer dans la maison-amphibie. Nous sommes ici "privés" de
l’image de la maison, laissée partielle, afin que nous venions
nous-mêmes la compléter, la faire advenir en "construction".
Les décrochements des arêtes transforment le cadre, non
seulement en découpe de l’espace, mais aussi en ornement autonome.
Pascal Convert, dans ses différentes versions de l’"Appartement
d’artiste", ramène la maison à une surface ajourée de motifs ;
l’architecture est devenue modénature, et le motif, "revêtement" et
modulation d’un volume planifié. La maison est sectionnée en "tranches"
superposées horizontalement les unes aux autres, espace planifié sans
point d’appui pour une inscription. La grille multiplie ainsi les
strates, rendant inassignable la maison. Cet espace à entrées multiples
est par définition désorienté, puisque pluriel ; il se donne comme un
"schème", une articulation entre le concept de maison et l’image de
maison, mettant en déroute la fonction mimétique de la maison. En
extrapolant une métaphore de Bernard Cache, l’on pourrait avancer que
la maison n’est plus un "modèle d’imitation", mais un "modèle de
simulation". La reproduction a fait place à l’ouverture anatomique. La
grille rend également asymétrique la maison, qui ne peut plus
vectorialiser ou étager ses éléments constitutifs. Dévectorialisée par
la grille, transformée en "tablature de cases" vides (Barthes), la
maison est redevenue potentiellement nomade. Elle témoigne désormais
d’une "impossibilité de clôture" (B. Cache), se résumant aux dermes
exfoliés de son corps exsangue. En 1963, Larry Bell avait appelé
"Bell’s House" un cube de miroirs, sectionné verticalement en barreaux,
comme une cage, et hermétiquement clos sur sa forme minimale. La maison
se donne comme un corps géométrique platonicien, idéal et immuable,
maison-cage, maison-boîte, qui ne recueille rien ; ni préhensible, ni
instrumentalisable, la maison est une grille qui nous diffracte sur ses
côtés.
Une maison pour tous
Pour Sylviane Agacinski, "une définition théorique de
l’homme qui ne tiendrait aucun compte de son inscription dans l’espace
et de son habitation serait idéaliste et métaphysique : ce serait celle
d’un sujet tombé du ciel ou venu d’un espace abstrait" (41).
"L’existence humaine n’est pas pensable avant toute possibilité de se
retirer dans un espace séparé. L’habitation (ou la "maison") est bien
une réalité concrète et empirique : mais, sans elle, l’homme qui
l’habite ne serait pas ce qu’il est. Autrement dit, la "maison" n’est
pas un objet en face d’un sujet qui se servirait d’elle comme un outil"
(42). Cet "outil" disparaît de fait dans l’appropriation de la maison
par les artistes, qui la transforment en "sujet" de la représentation,
modélisant ce "modèle" de définition de l’espace privé. Ce "retrait du
particulier dans un espace qui peut lui assurer une vie privée,
c’est-à-dire séparée de la vie publique" (Hannah Arendt) a été
compromis dans la pratique des artistes qui feront fusionner dans la
maison espace privé et public, notamment en ramenant la maison à un
objet à l’échelle intermédiaire entre celle de la maquette et celle,
réelle, de la maison. Cet "objet" à l’échelle hybride pourra s’avérer
ouvert sur l’espace extérieur, sans offrir cependant une véritable
habitabilité. L’habitation pourra se présenter sous une autre forme
d’exclusion du sujet, celle de la façade. Au début des années 1990,
Fareed Armaly et Christian Philipp Müller réalisèrent en Allemagne une
réplique à l’échelle 1:1 de la façade de la Galerie Nagel dans un parc.
Selon un plan de François Cuvilliés, la réplique se situe au bord de la
forêt, comme un décor de film ; la façade restant ouverte à l’arrière,
elle permet à la nature d’être visible à travers les fenêtres. En 1981,
David Hammons avait reconstitué une façade de maison à l’échelle 1 :
1 : la maison n’est plus qu’un décor tendu dans l’espace public, une
enveloppe dénuée de tout contenu. La maison n’est plus qu’une
scénographie architecturale désuète ou obsolète, sans espace intérieur
à investir, réduite à son propre simulacre, dénué d’intériorité.
En 1976, à Philadelphia, l’architecte Robert Venturi
conçut un musée à la mémoire de Benjamin Franklin, à l’endroit même où
celui-ci avait fait bâtir sa propre maison, dont les plans exacts
étaient inconnus (Venturi, Scott Brown and Associates, Inc., Franklin
Court, Independance National Historical Park, Philadelphia). Venturi
construisit "une maison-fantôme, une œuvre conceptuelle" (Dan Graham),
évoquant tout à la fois les cubes de Sol LeWitt, le Bauhaus et
l’urbanisme moderniste, pour représenter la forme que pouvait avoir
cette maison à travers notre connaissance incomplète de celle-ci : un
cadre schématique en acier, simple structure linéaire, et deux formes
cubiques accrochées à l’arête du toit surmontée d’une cheminée,
suffirent à en rendre compte (39). L’espace d’exposition qui comprend
des objets ayant appartenu à la maison se trouve au sous-sol, où des
vitrines donnent aux visiteurs l’accès aux fouilles de la fondation,
aux restes archéologiques de la maison réduite à la présence spectrale
d’une structure en acier "fantômatique". Des citations de lettres
adressées par Franklin à sa femme au cours de la construction de cette
maison furent gravées dans le pavement, insufflant une dimension
narrative et un temps rétroactif à la grille immuable qui incarne
désormais cette maison, tandis que les cinq maisons historiques en face
de la maison Franklin furent reconstruites. Cette "ghost house" est
habitée par la perte et l’exhumation de cette perte, transformée en
image vouée à l’incomplétude dans sa forme et sa fonction. La maison
est un objet perdu, dont seule la grille, devenue la maison
anamorphosée, peut témoigner, parce que la grille n’abrite ni
n’occulte, mais se donne juste comme un seuil de translation de
l’espace et du temps, de déplacement de l’ancrage de la maison.
Dans les années 1990, de nombreux artistes
dépouillèrent la maison en "cadre" ou en grille architecturant
l’espace, ne conservant plus de la maison que ses "arêtes", ainsi la
série de maquettes réalisées par Jef Geys, où la maison s’inscrit entre
une abstraction constructiviste et un jeu de construction multipliant
les plans orthogonaux. La "Spin House" de Tony Brown se donne comme une
surface régulée de grilles qui laisse entrevoir un espace intérieur,
structure tout à la fois cloisonnée comme un espace carcéral ou une
cage, et ouverte en claire-voie. Après sa célèbre installation à la
Fondation Saatchi, où l’immensité d’une surface d’huile faisait se
réfléchir l’espace alentour, provoquant une perte d’orientation, mais
surtout architecturant l’espace uniquement à partir d’elle, l’artiste
anglais Richard Wilson réalisa en 1996 "Room 6, Channel View Hotel",
translation des volumes et des plans d’un appartement en lignes
tubulaires, reposant sur des roulettes. La maison se réduisait à la
représentation diagrammatique de ses différents espaces fonctionnels,
rendus mobiles, déplaçables. Permutant intérieur et extérieur, la
grille rend la maison à sa mobilité, assure à travers la translation
des espaces le déplacement de ses fondations. Si l’architecture se
réduit à un "emboîtement de formes cadrantes" (40), à une mise en abyme
d’elle-même, la grille en est devenue la quintessence ; désormais la
maison est un cadre démultiplié, mis en abyme, mais qui n’encadre plus
rien, sinon le vide. Ce cadre, qui s’est autonomisé en architecture,
n’ouvre plus comme une fenêtre sur quelque chose, parce qu’il n’y a
plus de foyer dans la maison-amphibie. Nous sommes ici "privés" de
l’image de la maison, laissée partielle, afin que nous venions
nous-mêmes la compléter, la faire advenir en "construction".
Les décrochements des arêtes transforment le cadre, non
seulement en découpe de l’espace, mais aussi en ornement autonome.
Pascal Convert, dans ses différentes versions de l’"Appartement
d’artiste", ramène la maison à une surface ajourée de motifs ;
l’architecture est devenue modénature, et le motif, "revêtement" et
modulation d’un volume planifié. La maison est sectionnée en "tranches"
superposées horizontalement les unes aux autres, espace planifié sans
point d’appui pour une inscription. La grille multiplie ainsi les
strates, rendant inassignable la maison. Cet espace à entrées multiples
est par définition désorienté, puisque pluriel ; il se donne comme un
"schème", une articulation entre le concept de maison et l’image de
maison, mettant en déroute la fonction mimétique de la maison. En
extrapolant une métaphore de Bernard Cache, l’on pourrait avancer que
la maison n’est plus un "modèle d’imitation", mais un "modèle de
simulation". La reproduction a fait place à l’ouverture anatomique. La
grille rend également asymétrique la maison, qui ne peut plus
vectorialiser ou étager ses éléments constitutifs. Dévectorialisée par
la grille, transformée en "tablature de cases" vides (Barthes), la
maison est redevenue potentiellement nomade. Elle témoigne désormais
d’une "impossibilité de clôture" (B. Cache), se résumant aux dermes
exfoliés de son corps exsangue. En 1963, Larry Bell avait appelé
"Bell’s House" un cube de miroirs, sectionné verticalement en barreaux,
comme une cage, et hermétiquement clos sur sa forme minimale. La maison
se donne comme un corps géométrique platonicien, idéal et immuable,
maison-cage, maison-boîte, qui ne recueille rien ; ni préhensible, ni
instrumentalisable, la maison est une grille qui nous diffracte sur ses
côtés.
Une maison pour tous
Pour Sylviane Agacinski, "une définition théorique de
l’homme qui ne tiendrait aucun compte de son inscription dans l’espace
et de son habitation serait idéaliste et métaphysique : ce serait celle
d’un sujet tombé du ciel ou venu d’un espace abstrait" (41).
"L’existence humaine n’est pas pensable avant toute possibilité de se
retirer dans un espace séparé. L’habitation (ou la "maison") est bien
une réalité concrète et empirique : mais, sans elle, l’homme qui
l’habite ne serait pas ce qu’il est. Autrement dit, la "maison" n’est
pas un objet en face d’un sujet qui se servirait d’elle comme un outil"
(42). Cet "outil" disparaît de fait dans l’appropriation de la maison
par les artistes, qui la transforment en "sujet" de la représentation,
modélisant ce "modèle" de définition de l’espace privé. Ce "retrait du
particulier dans un espace qui peut lui assurer une vie privée,
c’est-à-dire séparée de la vie publique" (Hannah Arendt) a été
compromis dans la pratique des artistes qui feront fusionner dans la
maison espace privé et public, notamment en ramenant la maison à un
objet à l’échelle intermédiaire entre celle de la maquette et celle,
réelle, de la maison. Cet "objet" à l’échelle hybride pourra s’avérer
ouvert sur l’espace extérieur, sans offrir cependant une véritable
habitabilité. L’habitation pourra se présenter sous une autre forme
d’exclusion du sujet, celle de la façade. Au début des années 1990,
Fareed Armaly et Christian Philipp Müller réalisèrent en Allemagne une
réplique à l’échelle 1:1 de la façade de la Galerie Nagel dans un parc.
Selon un plan de François Cuvilliés, la réplique se situe au bord de la
forêt, comme un décor de film ; la façade restant ouverte à l’arrière,
elle permet à la nature d’être visible à travers les fenêtres. En 1981,
David Hammons avait reconstitué une façade de maison à l’échelle 1 :
1 : la maison n’est plus qu’un décor tendu dans l’espace public, une
enveloppe dénuée de tout contenu. La maison n’est plus qu’une
scénographie architecturale désuète ou obsolète, sans espace intérieur
à investir, réduite à son propre simulacre, dénué d’intériorité.
![Composition visuelle [architecture] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: Composition visuelle [architecture]
Re: Composition visuelle [architecture]
La maison-mobilier
En 1974, Armajani commence à travailler sur une série
d’objets architecturaux en carton (maisons, abris) qu’il nomme
"Dictionary for a Building". Armajani "modifiait la forme, la fonction
et la disposition de tous les éléments d’une maison (escaliers, portes,
fenêtres, etc), voire même la raison d’être d’une maison en tant que
telle". Il s’emparait des plans, surfaces, lignes, de l’architecture
américaine traditionnelle. Ses études sur l’ameublement, les éléments
architecturaux et les situations spatiales débouchèrent sur des
constructions dépourvues de fondations. "Ses premières maisons sont des
constructions schématiques qui représentent le "domicile", mais où l’on
ne peut entrer" (43). Parmi les influences de Siah Armajani (Teheran,
1939), sont souvent cités le poète Ralph Waldo Emerson, Herman
Melville, Walt Whitman et William Carlos Williams pour ses
collages-constructions, le pragmatisme de John Dewey, les architectes
Louis Kahn, Cesare Pelli, ainsi que le constructivisme russe. Armajani
s’inspira pour ses maquettes d’habitation d’études réalisées par Thomas
Jefferson pour sa propre maison à Monticello en Virginie vers 1770,
maison en brique rouge intégrée à l’architecture vernaculaire qui
découlait des proportions de Palladio, en particulier de la "Villa
Rotonda" à Vicenze vers 1570. Cette maison au style colonial promouvait
un retour néo-classique à l’antique ("Thomas Jefferson’s House ; East
Wing, Night House", 1975), de même que "Lissitsky’s Neighborhood Center
House", en 1978, témoigne de l’héritage de l’esthétique du
constructivisme. En 1970, Armajani réalisa "First House" à Minneapolis
avant de développer à partir de 1978 "une succession rapide de modèles
de maisons grandeur nature, chacune conçue méthodiquement pour répondre
à différentes problématiques". Ces constructions à plus grande échelle
s’appelleront "reading rooms", "reading gardens", "reading houses",
etc., la plus célèbre étant "Reading House" en 1979. Armajani "commença
par inverser le processus de construction", plaçant d’abord le mobilier
(bancs de lecture), ensuite les fenêtres orientées selon le soleil, et
les murs avec les fenêtres. Érigée de façon permanente à l’occasion des
Jeux olympiques d’hiver de Lake Placid, "Reading House" ressemble à un
garage dont les quatre façades sont différentes. "Tout paraît
légèrement décalé depuis l’extérieur" (44). Ces maisons ou ces modèles
de maisons sont construits en analysant séparément leurs éléments,
réassemblés ensuite dans un processus de déconstruction. "Ainsi
Armajani devint un artiste "civique" à la recherche d’espaces possédant
une densité potentielle en matière de communication" (45). "Les
premiers ponts et les premières maisons d’Armajani mettent en œuvre la
méthode déconstructive dans le but d’étudier les questions
fondamentales qui sont pourquoi, comment et dans quelles circonstances
une chose se présente, appartenant au passé et faisant encore sens
aujourd’hui" (46). "La maison n’est pas là pour altérer ou rehausser le
lieu donné. Elle remplit simplement l’espace.... La géométrie est
dominée par l’idée de "quelque" et de "n’importe quel". La "spatialité"
de l’espace n’entre en aucune façon dans notre raisonnement
"géométrique". ..."La maison est quelque chose qui se situe ’entre’ ...
C’est à travers une action accomplie dans des situations concrètes que
la maison a acquis un certain caractère. Elle est une entité réelle...
Le but du modèle est d’expliquer l’émergence du plus abstrait à partir
du plus concret. Bref, le modèle explique l’abstraction et non pas la
concrétisation.... Notre rapport aux choses n’est pas immédiatement
celui de sujet/objet" (47). "La maison est dans le lieu" : les maisons
"déconstruites" d’Armajani se situent à l’interface entre la sculpture
et l’architecture ; le mobilier y acquiert une dimension tectonique
nouvelle. L’usage demandé au visiteur permettra de permuter les axes de
compréhension de l’espace architectural, activé par la dimension
habituellement passive de la lecture dans les "reading rooms". À vrai
dire, les "maisons" d’Armajani sont soumises à un processus
d’élémentarisation de leurs composants, où la façade, par exemple, ou
un banc acquièreront une autonomie visuelle. C’est le mobilier, le
design de l’objet, qui est désormais porteur de la dimension
architectonique de la maison qui ne fonctionne plus comme écrin d’un
espace privé, mais outil de connexion sur l’espace public.
Aux États-Unis, Jennifer Bartlett réalise sa première
maison en 1969 ("House Piece", 1970), et jusqu’aux années 1990,
construit des maisons, à l’échelle intermédiaire entre celle d’une
habitation et d’une maquette, typifiant chacune de ses composantes.
Allan Wexler, architecte et artiste, travaillant sur ce thème depuis la
fin des années 1960, construisit en 1994 "Vinyl Milford House", un
bâtiment dont l’intérieur reste vide, conçu pour un seul objet, inspiré
par la cabane de H.D. Thoreau. En 1980, il avait construit "Little
Building for two Activities", bâtiment trop petit pour manger et dormir
à la fois, ou encore, en 1991, "Crate House", cube où quatre maisons
mobiles sont fixées sur des roues. Pour Wexler, comme pour Armajani, la
maison émane du mobilier, se donne elle-même comme l’extrapolation du
mobilier devenu tectonique. De nombreux artistes installèrent des
"maisons" dans l’espace public : "Das Haus" de Fischli & Weiss à
Münster en 1987, immeuble commercial de quatre étages reproduit à
l’échelle 1 : 5, se donne à l’échelle du mobilier urbain dans l’espace
public. Dans les années 1990, "Huisje" (1993) de Jan van de Pavert à
Amsterdam est envisagé comme une "exposition en soi" (48), autour de
laquelle l’on tourne comme autour d’un objet disproportionné, à nouveau
rétif à toute dimension habitable.
Une maison de maçons
Si, dès la fin des années 1960, Marcel Broodthaers
avait proclamé : "L’architecte est absent" (dans "Le Corbeau et le
Renard", ou encore, "au pied du mur, le maçon, le limaçon qui construit
sa maison"), Luc Deleu mettra en œuvre cette absence dans sa démarche
artistique. Architecte et artiste, il fonde en Belgique en 1970 le
T.O.P. Office, bureau pour le design urbain et l’architecture. En 1978,
il réalise avec des branchages "Nid d’oiseau", dérision de la maison,
et propose d’abolir l’ordre des architectes, réclamant pour chacun le
droit de construire sa propre maison. À ce titre, il invente un procédé
de construction de maisons en commençant par le toit, de même que les
animaux commencent par le haut pour construire leurs abris. Il décide
ainsi de construire des maisons ready-made à partir des dessins des
clients, et construisit, entre 1979 et 1985, cent cinquante maisons de
ce type en Belgique, rassemblées sous le titre "Luc Deleu Manifesto to
the Order" (1982). Luc Deleu en signa simplement le plan, se
réappropriant la maison par sa signature comme un objet ready-made.
Cette attitude le mène dans les années 1980 à dénoncer la
verticalisation de l’architecture en réalisant des installations axées
sur l’horizontalisation à travers une réflexion sur l’échelle et la
perspective (49).
En 1988, un autre artiste belge, Guillaume Bijl,
installe, comme Pavillon à Venise, une maison standard, "maison
Bouygues, maison de maçons", qu’il dépose comme un objet ready-made
dans ce contexte artistique. Par la suite, Bijl s’appropria des
caravanes qu’il installa dans des espaces publics ou des lieux
d’exposition. La maison se donne ironiquement sous le signe du
prêt-à-habiter, où les pavillons achetés sur un plan sont sensés rendre
compte de l’individualité de son occupant.
En 1990, Cildo Mereiles élabora un "Projet pour quatre
villes (Glasgow/Ghost House)", qui consistait à construire un logement
social, qui soit une réplique à échelle réelle d’une habitation sociale
entre les City Chambers. Le permis de construire lui ayant été refusé,
il proposa d’installer une maquette à l’endroit prévu pour ces
logements, suspendue sur un câble au-dessus de la tête des passants,
entre le centre et les parties périphériques de la ville (50). La
maison réelle construite dans le cadre d’une démarche artistique pour
Luc Deleu, destinée à être habitée, et la maison réelle transposée dans
un contexte artistique pour Guillaume Bijl, qui ne peut qu’être
contemplée, nous offrent les deux versants d’une attitude où, d’un
côté, c’est l’intentionnalité qui donne à la maison sa spécificité
d’objet d’art et de l’autre, sa contextualisation. Cildo Mereiles
souhaitait, quant à lui, en construire une "réplique" à l’identique et
l’"exposer" dans un espace public, tout à la fois comme maison et objet
d’art. La maison offre à ces artistes la possibilité de conjoindre dans
un seul "objet" fonction et représentation symbolique ; la maison est
cet "outil" qui permet de passer d’un statut esthétique à un statut
instrumental sans perte d’identité.
En 1974, Armajani commence à travailler sur une série
d’objets architecturaux en carton (maisons, abris) qu’il nomme
"Dictionary for a Building". Armajani "modifiait la forme, la fonction
et la disposition de tous les éléments d’une maison (escaliers, portes,
fenêtres, etc), voire même la raison d’être d’une maison en tant que
telle". Il s’emparait des plans, surfaces, lignes, de l’architecture
américaine traditionnelle. Ses études sur l’ameublement, les éléments
architecturaux et les situations spatiales débouchèrent sur des
constructions dépourvues de fondations. "Ses premières maisons sont des
constructions schématiques qui représentent le "domicile", mais où l’on
ne peut entrer" (43). Parmi les influences de Siah Armajani (Teheran,
1939), sont souvent cités le poète Ralph Waldo Emerson, Herman
Melville, Walt Whitman et William Carlos Williams pour ses
collages-constructions, le pragmatisme de John Dewey, les architectes
Louis Kahn, Cesare Pelli, ainsi que le constructivisme russe. Armajani
s’inspira pour ses maquettes d’habitation d’études réalisées par Thomas
Jefferson pour sa propre maison à Monticello en Virginie vers 1770,
maison en brique rouge intégrée à l’architecture vernaculaire qui
découlait des proportions de Palladio, en particulier de la "Villa
Rotonda" à Vicenze vers 1570. Cette maison au style colonial promouvait
un retour néo-classique à l’antique ("Thomas Jefferson’s House ; East
Wing, Night House", 1975), de même que "Lissitsky’s Neighborhood Center
House", en 1978, témoigne de l’héritage de l’esthétique du
constructivisme. En 1970, Armajani réalisa "First House" à Minneapolis
avant de développer à partir de 1978 "une succession rapide de modèles
de maisons grandeur nature, chacune conçue méthodiquement pour répondre
à différentes problématiques". Ces constructions à plus grande échelle
s’appelleront "reading rooms", "reading gardens", "reading houses",
etc., la plus célèbre étant "Reading House" en 1979. Armajani "commença
par inverser le processus de construction", plaçant d’abord le mobilier
(bancs de lecture), ensuite les fenêtres orientées selon le soleil, et
les murs avec les fenêtres. Érigée de façon permanente à l’occasion des
Jeux olympiques d’hiver de Lake Placid, "Reading House" ressemble à un
garage dont les quatre façades sont différentes. "Tout paraît
légèrement décalé depuis l’extérieur" (44). Ces maisons ou ces modèles
de maisons sont construits en analysant séparément leurs éléments,
réassemblés ensuite dans un processus de déconstruction. "Ainsi
Armajani devint un artiste "civique" à la recherche d’espaces possédant
une densité potentielle en matière de communication" (45). "Les
premiers ponts et les premières maisons d’Armajani mettent en œuvre la
méthode déconstructive dans le but d’étudier les questions
fondamentales qui sont pourquoi, comment et dans quelles circonstances
une chose se présente, appartenant au passé et faisant encore sens
aujourd’hui" (46). "La maison n’est pas là pour altérer ou rehausser le
lieu donné. Elle remplit simplement l’espace.... La géométrie est
dominée par l’idée de "quelque" et de "n’importe quel". La "spatialité"
de l’espace n’entre en aucune façon dans notre raisonnement
"géométrique". ..."La maison est quelque chose qui se situe ’entre’ ...
C’est à travers une action accomplie dans des situations concrètes que
la maison a acquis un certain caractère. Elle est une entité réelle...
Le but du modèle est d’expliquer l’émergence du plus abstrait à partir
du plus concret. Bref, le modèle explique l’abstraction et non pas la
concrétisation.... Notre rapport aux choses n’est pas immédiatement
celui de sujet/objet" (47). "La maison est dans le lieu" : les maisons
"déconstruites" d’Armajani se situent à l’interface entre la sculpture
et l’architecture ; le mobilier y acquiert une dimension tectonique
nouvelle. L’usage demandé au visiteur permettra de permuter les axes de
compréhension de l’espace architectural, activé par la dimension
habituellement passive de la lecture dans les "reading rooms". À vrai
dire, les "maisons" d’Armajani sont soumises à un processus
d’élémentarisation de leurs composants, où la façade, par exemple, ou
un banc acquièreront une autonomie visuelle. C’est le mobilier, le
design de l’objet, qui est désormais porteur de la dimension
architectonique de la maison qui ne fonctionne plus comme écrin d’un
espace privé, mais outil de connexion sur l’espace public.
Aux États-Unis, Jennifer Bartlett réalise sa première
maison en 1969 ("House Piece", 1970), et jusqu’aux années 1990,
construit des maisons, à l’échelle intermédiaire entre celle d’une
habitation et d’une maquette, typifiant chacune de ses composantes.
Allan Wexler, architecte et artiste, travaillant sur ce thème depuis la
fin des années 1960, construisit en 1994 "Vinyl Milford House", un
bâtiment dont l’intérieur reste vide, conçu pour un seul objet, inspiré
par la cabane de H.D. Thoreau. En 1980, il avait construit "Little
Building for two Activities", bâtiment trop petit pour manger et dormir
à la fois, ou encore, en 1991, "Crate House", cube où quatre maisons
mobiles sont fixées sur des roues. Pour Wexler, comme pour Armajani, la
maison émane du mobilier, se donne elle-même comme l’extrapolation du
mobilier devenu tectonique. De nombreux artistes installèrent des
"maisons" dans l’espace public : "Das Haus" de Fischli & Weiss à
Münster en 1987, immeuble commercial de quatre étages reproduit à
l’échelle 1 : 5, se donne à l’échelle du mobilier urbain dans l’espace
public. Dans les années 1990, "Huisje" (1993) de Jan van de Pavert à
Amsterdam est envisagé comme une "exposition en soi" (48), autour de
laquelle l’on tourne comme autour d’un objet disproportionné, à nouveau
rétif à toute dimension habitable.
Une maison de maçons
Si, dès la fin des années 1960, Marcel Broodthaers
avait proclamé : "L’architecte est absent" (dans "Le Corbeau et le
Renard", ou encore, "au pied du mur, le maçon, le limaçon qui construit
sa maison"), Luc Deleu mettra en œuvre cette absence dans sa démarche
artistique. Architecte et artiste, il fonde en Belgique en 1970 le
T.O.P. Office, bureau pour le design urbain et l’architecture. En 1978,
il réalise avec des branchages "Nid d’oiseau", dérision de la maison,
et propose d’abolir l’ordre des architectes, réclamant pour chacun le
droit de construire sa propre maison. À ce titre, il invente un procédé
de construction de maisons en commençant par le toit, de même que les
animaux commencent par le haut pour construire leurs abris. Il décide
ainsi de construire des maisons ready-made à partir des dessins des
clients, et construisit, entre 1979 et 1985, cent cinquante maisons de
ce type en Belgique, rassemblées sous le titre "Luc Deleu Manifesto to
the Order" (1982). Luc Deleu en signa simplement le plan, se
réappropriant la maison par sa signature comme un objet ready-made.
Cette attitude le mène dans les années 1980 à dénoncer la
verticalisation de l’architecture en réalisant des installations axées
sur l’horizontalisation à travers une réflexion sur l’échelle et la
perspective (49).
En 1988, un autre artiste belge, Guillaume Bijl,
installe, comme Pavillon à Venise, une maison standard, "maison
Bouygues, maison de maçons", qu’il dépose comme un objet ready-made
dans ce contexte artistique. Par la suite, Bijl s’appropria des
caravanes qu’il installa dans des espaces publics ou des lieux
d’exposition. La maison se donne ironiquement sous le signe du
prêt-à-habiter, où les pavillons achetés sur un plan sont sensés rendre
compte de l’individualité de son occupant.
En 1990, Cildo Mereiles élabora un "Projet pour quatre
villes (Glasgow/Ghost House)", qui consistait à construire un logement
social, qui soit une réplique à échelle réelle d’une habitation sociale
entre les City Chambers. Le permis de construire lui ayant été refusé,
il proposa d’installer une maquette à l’endroit prévu pour ces
logements, suspendue sur un câble au-dessus de la tête des passants,
entre le centre et les parties périphériques de la ville (50). La
maison réelle construite dans le cadre d’une démarche artistique pour
Luc Deleu, destinée à être habitée, et la maison réelle transposée dans
un contexte artistique pour Guillaume Bijl, qui ne peut qu’être
contemplée, nous offrent les deux versants d’une attitude où, d’un
côté, c’est l’intentionnalité qui donne à la maison sa spécificité
d’objet d’art et de l’autre, sa contextualisation. Cildo Mereiles
souhaitait, quant à lui, en construire une "réplique" à l’identique et
l’"exposer" dans un espace public, tout à la fois comme maison et objet
d’art. La maison offre à ces artistes la possibilité de conjoindre dans
un seul "objet" fonction et représentation symbolique ; la maison est
cet "outil" qui permet de passer d’un statut esthétique à un statut
instrumental sans perte d’identité.
![Composition visuelle [architecture] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: Composition visuelle [architecture]
Re: Composition visuelle [architecture]
La domiciliation de l’image
Eugène Atget à travers ses photographies de Paris, au
début du siècle, August Sander, Walker Evans, dans les années 1930,
photographièrent la maison et la ville dans une démarche objectiviste,
Evans marquant de son empreinte les photos de suburbs de Dan Graham
dans les années 1960. En commençant à photographier dès 1957 la région
industrielle de Siegen, près de Cologne, Bernd et Hilla Becher
inaugurait le début des typologies architecturales dans leurs
photographies de maisons de travailleurs du sud de la Westphalie,
abordant de manière frontale et objectiviste leur style vernaculaire,
et déclinant des vues apparemment identiques de ces structures. Vers le
milieu des années 1980, l’école allemande, avec des artistes tels que
Thomas Ruff, réinterprétèrent cette "nouvelle objectivité" (Neue
Sachlichkeit), dans le sillage des Becher, à travers des "portraits" de
jeunes gens anonymes, de constellations ou de maisons qui se
rassemblent dans un même statut d’image réifiée. Ed Ruscha, dans "Every
Building on the Sunset Strip" en 1966, dressa l’inventaire
photographiques de maisons le long d’un boulevard de deux kilomètres.
Cette démarche d’énumération des éléments ou de volonté d’exhaustion
d’une catégorie d’objets se retrouvera, différemment, chez les artistes
qui décomposeront la maison en ses éléments constitutifs. Dans les
années 1990, Melvin Charney, ou de jeunes artistes, - Hughes Reip, en
France, Andrea Sperni, en Italie -, réduisent la maison à une
nomenclature d’éléments typifiés, ainsi les "50 profils d’architecture
extraits d’une encyclopédie" de Sperni, ou les images d’ordinateur
d’Hughes Reip, qui opèrent une réduction sémantique de l’objet maison.
L’artiste canadien Roy Arden renoue avec l’approche
anthropologique de Walker Evans dans une démarche subjective : "Je
recherche des traces du passé, l’obsolète et l’archaïque à la surface
du présent. J’essaie aussi de rendre compte de l’appparence
traumatique, brutale du nouveau. Il y a des types particuliers de
maisons plus vieilles... Je cherche des maisons qui n’ont pas été
"rénovées" parce que je veux que l’image fonctionne comme un portrait"
(51). L’anthropomorphisme de la maison reste l’axe dominant de ces
photographies ; l’architecture vernaculaire, qui entre en conflit avec
le développement suburbain, enregistre "l’expérience du présent dans
des fictions picturales qui forcent les autres à reconnaître le réel
réprimé dans des images standard du présent", déclare Roy Arden. Dans
les "Transformer Houses (Bungalow-Style Substations)", Robin Collyer
déstabilise nos codes de reconnaissance : ces constructions, qui
offrent l’apparence d’une maison, ne sont que des répliques, des
succédanés, fonctionnant comme des stations électriques s’efforçant de
s’intéger à leur environnement. Dans une démarche similaire, les
"Monster Homes" sont comme des nouvelles maisons construites dans
d’anciens quartiers, mais trop grandes et trop ostentatoires, soumises
à l’inflation de leur valeur de signe.
James Casebere se livre, quant à lui, à une démarche de
récréation de l’architecture dans ses photographies noir et blanc. Il
commence par constuire de petites maquettes en carton qu’il
photographie ensuite dans une atmosphère cinématographique aux
clairs-obscurs exacerbés, qui confèrent une dimension narrative à ces
simulacres fantômatiques d’architecture. De même, Thomas Demand
commence par construire et peindre la maquette en carton d’un bâtiment
qu’il photographie avant de la détruire. L’image est ensuite développée
en couleur à l’échelle de l’objet. Le résultat, proche du réalisme
documentaire, débouche lui-aussi sur un monde déshumanisé.
La maison, un seuil "affecté"
En 1956, le collage de Richard Hamilton, qui annonçait
le pop art, "Just what is it that makes today’s homes so different, so
appealing ?" véhiculait une imagerie hétérogène et populaire de la
maison, en rupture avec son aseptisation. En 1964, dans la mouvance
pop, Richard Artschwager adopte une imagerie architecturale, tirée du
"New York Post" avec "Tract Home" (1964), ou "High-Rise Apartment",
représentations délibérément stéréotypées de maisons, prisonnières dans
des cadres en formica qui les isolent. Dans les années 1990, Christophe
Vigouroux récupère des images trouvées (publicités, journaux) qu’il
extrait de leur contexte, et dépose sur l’écran de la toile. Selon la
projection, l’image est déformée, étirée, recadrée. La représentation
picturale de la maison se rapprochera le plus souvent d’une narrativité
où la maison est portée en dérision.
Au "grand récit" de l’architecture, aurait ainsi fait
place le "récit mineur" de la maison, ce micro-récit seul à même de
prendre les mensurations de l’humain. Entre le monument et l’objet,
prise dans un statut hybride, la maison demeure l’ultime instance de
subjectivation de l’espace, unité atomisée et syncrétique à la fois,
susceptible de recueillir autant une narration individuée que la
formalisation la plus abstraite. La maison permet d’évoluer à travers
deux attitudes réversibles, "représenter la construction" et
"construire la représentation" pour extrapoler Paul Virilio (52). Seule
la maison réunirait le singulier et le générique, l’ancrage et le
cadre, la parodie et l’allégorie. Elle supporte également la réduction
sémantique du modèle, le mouvement de duplication en réplique ou en
simulacre. Extérieure aux modes de production artistique, la maison est
une étrange alternative au sujet comme à l’objet, par son rattachement
à un territoire, aux dimensions constructives de l’architecture. Le
sujet peut s’y incarner sans s’y montrer ; l’objet peut s’y montrer,
sans s’y instrumentaliser. Pourtant la maison met bien en place des
procédures représentationnelles, fascinées par la mise en abyme et la
tautologie : la maison se décrit elle-même, se développe en simulacres
sans fin. Elle permet d’échapper à la "production" d’un objet "autre"
pour ouvrir sur la translation des catégories d’espace et de temps.
Joyau de la privacité, la maison était ce lieu par excellence affecté,
mu par la prescription de l’affect, du singulier et du "propre".
Ancrage d’une subjectivité, elle est aussi portée par une dimension
événementielle car qui dit maison dit expérience et traversée du temps.
Son statut est en soi transformatif, et peut ainsi rejoindre ce que
Paul Virilio nomme, dans un autre contexte, "l’atopie domicilaire".
Dans "La maison d’Erasme de Rotterdam", Eugenio
Dittborn élabora le projet de construire une maison à l’aide des
dessins d’une dizaine de personnes, réalisée à travers un
questionnaire :
![Composition visuelle [architecture] L8xH11_puce-68c92](https://2img.net/h/journal3.net/local/cache-vignettes/L8xH11_puce-68c92.gif) "dans quelle type de maison aimeriez-vous vivre ?
"dans quelle type de maison aimeriez-vous vivre ?
![Composition visuelle [architecture] L8xH11_puce-68c92](https://2img.net/h/journal3.net/local/cache-vignettes/L8xH11_puce-68c92.gif) dessinez le plan de cette maison
dessinez le plan de cette maison
![Composition visuelle [architecture] L8xH11_puce-68c92](https://2img.net/h/journal3.net/local/cache-vignettes/L8xH11_puce-68c92.gif) dessinez la façade de cette maison
dessinez la façade de cette maison
![Composition visuelle [architecture] L8xH11_puce-68c92](https://2img.net/h/journal3.net/local/cache-vignettes/L8xH11_puce-68c92.gif) lorsque vous aviez dix ans, dans quel type de maison habitiez-vous ?
lorsque vous aviez dix ans, dans quel type de maison habitiez-vous ?
![Composition visuelle [architecture] L8xH11_puce-68c92](https://2img.net/h/journal3.net/local/cache-vignettes/L8xH11_puce-68c92.gif) où" ?
où" ?
La maison se construit de la sorte au confluent de
différentes couches mnémoniques, visuelles et textuelles, rassemblées à
partir de l’approche de plusieurs personnes. C’est une subjectivité
collective qui dresse ses fondations, projection des archétypes (plan,
façade, etc).
À travers la maison, l’œuvre d’art revivrait son
fantasme de se transformer en "représentation" de "lieu", que l’on ne
peut arpenter, et qui se dresse devant nous avec la multitude de ses
archétypes et de ses faux-semblants. Tout peut faire "figure" de
"maison" puisque la maison est ce que l’on y projette. Mais la "maison"
n’aurait-elle pas réintroduit, dans l’art, l’antique dichotomie de
l’objet et du sujet qui continuent de s’y débattre ? Le déplacement
spéculaire de ses fondations l’a transformée en entité vacillante, en
objet perdu dans ses analogons, et nous ne sommes plus que l’empreinte
de son image fracturée.
La maison serait une sorte de topique qui défigure le
sujet, reconfigure le lieu, figure l’objet, dans un mouvement
spéculatif de mises en abyme. Tout à la fois instance de mémoire et
projection dans le futur, la maison est un document anthropologique
décortiqué par l’art contemporain. Cildo Mereiles raconte que, alors
qu’il avait sept ou huit ans, il vit passer un homme depuis sa maison
dans un village qui s’installa pour la nuit un peu plus loin. Le matin,
l’enfant se dirigea vers cet endroit : "Il était déjà parti, mais ce
que je trouvai là-bas fut peut-être la chose la plus décisive quant au
chemin que j’ai pris ensuite dans la vie. Durant la nuit il avait
construit une petite maison, une maison miniature, avec des petites
briques. Une maison parfaite, avec les fenêtres qui s’ouvraient, les
portes... Je demeurai très frappé par cela. Je présume un impact plus
grand : la possibilité que l’on a de faire des choses et de les laisser
pour les autres". La maison comme seuil "affecté" entre soi et le monde.
Eugène Atget à travers ses photographies de Paris, au
début du siècle, August Sander, Walker Evans, dans les années 1930,
photographièrent la maison et la ville dans une démarche objectiviste,
Evans marquant de son empreinte les photos de suburbs de Dan Graham
dans les années 1960. En commençant à photographier dès 1957 la région
industrielle de Siegen, près de Cologne, Bernd et Hilla Becher
inaugurait le début des typologies architecturales dans leurs
photographies de maisons de travailleurs du sud de la Westphalie,
abordant de manière frontale et objectiviste leur style vernaculaire,
et déclinant des vues apparemment identiques de ces structures. Vers le
milieu des années 1980, l’école allemande, avec des artistes tels que
Thomas Ruff, réinterprétèrent cette "nouvelle objectivité" (Neue
Sachlichkeit), dans le sillage des Becher, à travers des "portraits" de
jeunes gens anonymes, de constellations ou de maisons qui se
rassemblent dans un même statut d’image réifiée. Ed Ruscha, dans "Every
Building on the Sunset Strip" en 1966, dressa l’inventaire
photographiques de maisons le long d’un boulevard de deux kilomètres.
Cette démarche d’énumération des éléments ou de volonté d’exhaustion
d’une catégorie d’objets se retrouvera, différemment, chez les artistes
qui décomposeront la maison en ses éléments constitutifs. Dans les
années 1990, Melvin Charney, ou de jeunes artistes, - Hughes Reip, en
France, Andrea Sperni, en Italie -, réduisent la maison à une
nomenclature d’éléments typifiés, ainsi les "50 profils d’architecture
extraits d’une encyclopédie" de Sperni, ou les images d’ordinateur
d’Hughes Reip, qui opèrent une réduction sémantique de l’objet maison.
L’artiste canadien Roy Arden renoue avec l’approche
anthropologique de Walker Evans dans une démarche subjective : "Je
recherche des traces du passé, l’obsolète et l’archaïque à la surface
du présent. J’essaie aussi de rendre compte de l’appparence
traumatique, brutale du nouveau. Il y a des types particuliers de
maisons plus vieilles... Je cherche des maisons qui n’ont pas été
"rénovées" parce que je veux que l’image fonctionne comme un portrait"
(51). L’anthropomorphisme de la maison reste l’axe dominant de ces
photographies ; l’architecture vernaculaire, qui entre en conflit avec
le développement suburbain, enregistre "l’expérience du présent dans
des fictions picturales qui forcent les autres à reconnaître le réel
réprimé dans des images standard du présent", déclare Roy Arden. Dans
les "Transformer Houses (Bungalow-Style Substations)", Robin Collyer
déstabilise nos codes de reconnaissance : ces constructions, qui
offrent l’apparence d’une maison, ne sont que des répliques, des
succédanés, fonctionnant comme des stations électriques s’efforçant de
s’intéger à leur environnement. Dans une démarche similaire, les
"Monster Homes" sont comme des nouvelles maisons construites dans
d’anciens quartiers, mais trop grandes et trop ostentatoires, soumises
à l’inflation de leur valeur de signe.
James Casebere se livre, quant à lui, à une démarche de
récréation de l’architecture dans ses photographies noir et blanc. Il
commence par constuire de petites maquettes en carton qu’il
photographie ensuite dans une atmosphère cinématographique aux
clairs-obscurs exacerbés, qui confèrent une dimension narrative à ces
simulacres fantômatiques d’architecture. De même, Thomas Demand
commence par construire et peindre la maquette en carton d’un bâtiment
qu’il photographie avant de la détruire. L’image est ensuite développée
en couleur à l’échelle de l’objet. Le résultat, proche du réalisme
documentaire, débouche lui-aussi sur un monde déshumanisé.
La maison, un seuil "affecté"
En 1956, le collage de Richard Hamilton, qui annonçait
le pop art, "Just what is it that makes today’s homes so different, so
appealing ?" véhiculait une imagerie hétérogène et populaire de la
maison, en rupture avec son aseptisation. En 1964, dans la mouvance
pop, Richard Artschwager adopte une imagerie architecturale, tirée du
"New York Post" avec "Tract Home" (1964), ou "High-Rise Apartment",
représentations délibérément stéréotypées de maisons, prisonnières dans
des cadres en formica qui les isolent. Dans les années 1990, Christophe
Vigouroux récupère des images trouvées (publicités, journaux) qu’il
extrait de leur contexte, et dépose sur l’écran de la toile. Selon la
projection, l’image est déformée, étirée, recadrée. La représentation
picturale de la maison se rapprochera le plus souvent d’une narrativité
où la maison est portée en dérision.
Au "grand récit" de l’architecture, aurait ainsi fait
place le "récit mineur" de la maison, ce micro-récit seul à même de
prendre les mensurations de l’humain. Entre le monument et l’objet,
prise dans un statut hybride, la maison demeure l’ultime instance de
subjectivation de l’espace, unité atomisée et syncrétique à la fois,
susceptible de recueillir autant une narration individuée que la
formalisation la plus abstraite. La maison permet d’évoluer à travers
deux attitudes réversibles, "représenter la construction" et
"construire la représentation" pour extrapoler Paul Virilio (52). Seule
la maison réunirait le singulier et le générique, l’ancrage et le
cadre, la parodie et l’allégorie. Elle supporte également la réduction
sémantique du modèle, le mouvement de duplication en réplique ou en
simulacre. Extérieure aux modes de production artistique, la maison est
une étrange alternative au sujet comme à l’objet, par son rattachement
à un territoire, aux dimensions constructives de l’architecture. Le
sujet peut s’y incarner sans s’y montrer ; l’objet peut s’y montrer,
sans s’y instrumentaliser. Pourtant la maison met bien en place des
procédures représentationnelles, fascinées par la mise en abyme et la
tautologie : la maison se décrit elle-même, se développe en simulacres
sans fin. Elle permet d’échapper à la "production" d’un objet "autre"
pour ouvrir sur la translation des catégories d’espace et de temps.
Joyau de la privacité, la maison était ce lieu par excellence affecté,
mu par la prescription de l’affect, du singulier et du "propre".
Ancrage d’une subjectivité, elle est aussi portée par une dimension
événementielle car qui dit maison dit expérience et traversée du temps.
Son statut est en soi transformatif, et peut ainsi rejoindre ce que
Paul Virilio nomme, dans un autre contexte, "l’atopie domicilaire".
Dans "La maison d’Erasme de Rotterdam", Eugenio
Dittborn élabora le projet de construire une maison à l’aide des
dessins d’une dizaine de personnes, réalisée à travers un
questionnaire :
![Composition visuelle [architecture] L8xH11_puce-68c92](https://2img.net/h/journal3.net/local/cache-vignettes/L8xH11_puce-68c92.gif) "dans quelle type de maison aimeriez-vous vivre ?
"dans quelle type de maison aimeriez-vous vivre ?![Composition visuelle [architecture] L8xH11_puce-68c92](https://2img.net/h/journal3.net/local/cache-vignettes/L8xH11_puce-68c92.gif) dessinez le plan de cette maison
dessinez le plan de cette maison![Composition visuelle [architecture] L8xH11_puce-68c92](https://2img.net/h/journal3.net/local/cache-vignettes/L8xH11_puce-68c92.gif) dessinez la façade de cette maison
dessinez la façade de cette maison![Composition visuelle [architecture] L8xH11_puce-68c92](https://2img.net/h/journal3.net/local/cache-vignettes/L8xH11_puce-68c92.gif) lorsque vous aviez dix ans, dans quel type de maison habitiez-vous ?
lorsque vous aviez dix ans, dans quel type de maison habitiez-vous ?![Composition visuelle [architecture] L8xH11_puce-68c92](https://2img.net/h/journal3.net/local/cache-vignettes/L8xH11_puce-68c92.gif) où" ?
où" ?La maison se construit de la sorte au confluent de
différentes couches mnémoniques, visuelles et textuelles, rassemblées à
partir de l’approche de plusieurs personnes. C’est une subjectivité
collective qui dresse ses fondations, projection des archétypes (plan,
façade, etc).
À travers la maison, l’œuvre d’art revivrait son
fantasme de se transformer en "représentation" de "lieu", que l’on ne
peut arpenter, et qui se dresse devant nous avec la multitude de ses
archétypes et de ses faux-semblants. Tout peut faire "figure" de
"maison" puisque la maison est ce que l’on y projette. Mais la "maison"
n’aurait-elle pas réintroduit, dans l’art, l’antique dichotomie de
l’objet et du sujet qui continuent de s’y débattre ? Le déplacement
spéculaire de ses fondations l’a transformée en entité vacillante, en
objet perdu dans ses analogons, et nous ne sommes plus que l’empreinte
de son image fracturée.
La maison serait une sorte de topique qui défigure le
sujet, reconfigure le lieu, figure l’objet, dans un mouvement
spéculatif de mises en abyme. Tout à la fois instance de mémoire et
projection dans le futur, la maison est un document anthropologique
décortiqué par l’art contemporain. Cildo Mereiles raconte que, alors
qu’il avait sept ou huit ans, il vit passer un homme depuis sa maison
dans un village qui s’installa pour la nuit un peu plus loin. Le matin,
l’enfant se dirigea vers cet endroit : "Il était déjà parti, mais ce
que je trouvai là-bas fut peut-être la chose la plus décisive quant au
chemin que j’ai pris ensuite dans la vie. Durant la nuit il avait
construit une petite maison, une maison miniature, avec des petites
briques. Une maison parfaite, avec les fenêtres qui s’ouvraient, les
portes... Je demeurai très frappé par cela. Je présume un impact plus
grand : la possibilité que l’on a de faire des choses et de les laisser
pour les autres". La maison comme seuil "affecté" entre soi et le monde.
![Composition visuelle [architecture] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: Composition visuelle [architecture]
Re: Composition visuelle [architecture]
Notes
(1) Joseph Rykwert, "La maison d’Adam au Paradis", Paris, Seuil, 1976.
(2) Georg Simmel, "La tragédie de la culture", Paris, Rivages, 1988, p. 164.
(3) Beatriz Colomina, "La publicité du privé", HYX, Orléans, 1997.
(4) Chris Younès, Michel Mangematin, L’ami de la
maison, Le philosophe chez l’architecte, p. 87 : "L’architecte comme le
philosophe sont confrontés à l’état de crise du rapport de l’homme à
l’espace de son habitation, ils ne peuvent ignorer les effets d’une
pensée de la séparation sujet-objet".
(5) Theodor Adorno, "Minima", p. 35-36, p. 64.
(6) Sylviane Agacinski, "Volume. Philosophies et politiques de l’architecture", Paris, Galilée, 1992, p. 138.
(7) Beatriz Colomina, "Domesticity at War", in Assemblage, New York, n° 22, décembre 1993.
( Anthony Vidler, "The Architectural Uncanny", ....
Anthony Vidler, "The Architectural Uncanny", ....
(9) Jonathan Crary, "Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the nineteenth Century", MIT Press, 1992.
(10) Steven Pippin, dans House converted into a Pinhole
Camera, en 1986, a d’ailleurs établi la conjonction entre maison et
camera obscura.
(11) Marc Perelman,"Le stade du verre de l’architecture
moderne comme transformateur du moi", p. 73-95 in "Dan Graham", Paris,
DisVoir, 1995.
(12) Cf. Frédéric Migayrou, "Bloc. Le monolithe fracturé", VIe Mostra d’Architecture de Venise, HYX/AFAA, Orléans, 1996.
(13) Farès el-Dahdah, "The Folly of S/M, recto verso" in Assemblage, MIT Press, n°16, août 1992, p. 7-19.
(14) Lorsque Per Barclay construisit au Centre d’art
contemporain de Vassivière en 1995 trois maisons de verre dont les
parois intérieures ruissellent d’eau, il rendait également la maison
impénétrable, pur objet de regard. Vannhus ou Maison d’eau est une
sculpture publique, construction en bois, dépourvue de porte et emplie
d’eau jusqu’au bas de ses quatre fenêtres. La nature envahit
l’intérieur de cette maison dans laquelle on ne peut entrer, seulement
regarder.
(15) Jeff Wall, "Kammerspiel de Dan Graham", Bruxelles, éd. Daled-Golschmidt, 1988.
(16) Gillo Dorflès, in Marie-Claude Mc Donald,
"Matérialisations. Production de masse, espace public et convention
archtiecturale dans l’œuvre de Dan Graham", p. 27- 72, "Dan Graham",
Paris, DisVoir, 1995.
(17) Catherine Millet, "Melvin Charney. Explorateur de la mémoire collective", in Art Press, mai 1995, p. 57.
(18) Cf. "Paraboles et autres allégories. L’œuvre de
Melvin Charney 1975-1990", Centre canadien d’architecture, Montréal,
1990 ; Kurt W. Forster, "Contradictions of Preservation and
Destruction" in Architext, MIT, Cambridge, décembre 1983.
(19) Gordon Matta-Clark, IVAM Centre Julio Gonzalez Valencia, Musée Cantini, Marseille, Serpentine Gallery, Londres, p. 208.
(20) Nancy Spector, "Robert Gober : Homeward-Bound" in Parkett, n° 27, 1991, p. 80.
(21) Beatriz Colomina, op. cit.
(22) Nancy Spector, ibidem.
(23) Nancy Spector, op. cit., p. 82.
(24) Cf. l’article de Carolyn Christov-Bakargiev dans ce même numéro sur la maison dans l’arte povera.
(25) Cf. l’article de Pascal Rousseau sur "Le vêtement-habitacle" dans le tome 2 de "La Maison".
(26) Nous ne sommes pas attachés dans cet article à
l’analyse de la représentation de l’espace intérieur dans l’art
contemporain, aux formes de domesticité extrêmement nombreuses mises en
scène par les artistes, mais aux différentes types d’appropriation de
la maison comme "objet" visuel et discursif, afin de voir comment la
maison "demeure" un "objet" sauvegardant un sujet unitaire quand bien
même ses bases seront rendues vacillantes.
(27) Ludger Gerdes, "Thomas Schütte", Von Hier Aus,
Cologne, 1984 ; réédité "A propos du "Modèle" chez Thomas Schütte",
cat. Kunsthalle Bern, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris,
Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven.
(28) Bernard Cache, "Terre meuble", HYX,Orléans, 1996.
(29) Michael Newman, "Artists’Architecture", ICA, Londres, 1983.
(30) Marc Augé, "Domaines et Châteaux", Paris, Seuil, Librairie du XXe siècle, 19889 ; p. 143.
(31) Ibid., p. 171.
(32) Corinne Robins, "Nature is a Mother with a Knife :
The Malevolent Landscapes of Ira Joel Haber in Arts", vol. 52, n° 3,
novembre 1977, p. 96-98 ; cf. aussi Carter Ratcliff, "Notes on Small
Scupture", Artforum, avril 1976, p. 42
(33) Mc Donald, 65.
(34) Jean-Pierre Raynaud, 308
(35) 310
(36) Ernst Bloch, "La maison nouvelle et la clarté
réelle" in "Le Principe Espérance. II Les épures d’un monde meilleur",
Paris, Gallimard, 1982, p. 377.
(37) Cf. l’article de Paolo Virno sur la prison dans ce même numéro.
(38) Robert Kleyn, p. 9
(39) Dan Graham, article paru dans Artforum.
(40) Bernard Cache, op. cit., p. 29.
(41) Sylviane Agacinski, op. cit., p. 32-33
(42) Ibidem.
(43) Patricia C.Phillips, "Siah Armajani" in Artforum, New York, décembre 1985, p. 152.
(44) Ibid.
(45) Ibid., p. 142
(46) Ibid., p. 143
(47) Siah Armajani, "Contributions anarchistes
1962-1994," Nice, Villa Arson, 3 juillet-2 octobre 1994, p. 73. Cf.
aussi Calvin Tomkins, "Siah Armajani. Profiles" in the New Yorker, 19
mars 1990 ; Paola Antonelli, "Siah Armajani 1968-89" in Domus, février
1990 ;
Jean-Christophe Ammann, "Siah Armajani", Kunsthalle Bâle, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1987.
(48) Mark Kremer, Stedelijk Van Abbemuseum, 1994 : "For
the past year I have been working on a video and a scale model of a
house... Another purpose of the house is similar to the purpose of an
exhibition... various parts of the house have the effect of a work of
art... So a walk round the house can be seen as a walk round an
exhibition"
(49) Luc Deleu, "Éthique de l’architecture", Tarabusta Editions, 1989 ; "Manifesto to the Order", Guy Schraenen, Anvers.
(50) "Cildo Mereiles", IVAM Centre del Carme, 1995.
(51) "Some Notes on My Pictures of Houses", 15 janvier 1996 (non publié).
(52) Paul Virilio, "L’espace critique", Paris, Christian Bourgois, 1984.
(1) Joseph Rykwert, "La maison d’Adam au Paradis", Paris, Seuil, 1976.
(2) Georg Simmel, "La tragédie de la culture", Paris, Rivages, 1988, p. 164.
(3) Beatriz Colomina, "La publicité du privé", HYX, Orléans, 1997.
(4) Chris Younès, Michel Mangematin, L’ami de la
maison, Le philosophe chez l’architecte, p. 87 : "L’architecte comme le
philosophe sont confrontés à l’état de crise du rapport de l’homme à
l’espace de son habitation, ils ne peuvent ignorer les effets d’une
pensée de la séparation sujet-objet".
(5) Theodor Adorno, "Minima", p. 35-36, p. 64.
(6) Sylviane Agacinski, "Volume. Philosophies et politiques de l’architecture", Paris, Galilée, 1992, p. 138.
(7) Beatriz Colomina, "Domesticity at War", in Assemblage, New York, n° 22, décembre 1993.
(
 Anthony Vidler, "The Architectural Uncanny", ....
Anthony Vidler, "The Architectural Uncanny", ....(9) Jonathan Crary, "Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the nineteenth Century", MIT Press, 1992.
(10) Steven Pippin, dans House converted into a Pinhole
Camera, en 1986, a d’ailleurs établi la conjonction entre maison et
camera obscura.
(11) Marc Perelman,"Le stade du verre de l’architecture
moderne comme transformateur du moi", p. 73-95 in "Dan Graham", Paris,
DisVoir, 1995.
(12) Cf. Frédéric Migayrou, "Bloc. Le monolithe fracturé", VIe Mostra d’Architecture de Venise, HYX/AFAA, Orléans, 1996.
(13) Farès el-Dahdah, "The Folly of S/M, recto verso" in Assemblage, MIT Press, n°16, août 1992, p. 7-19.
(14) Lorsque Per Barclay construisit au Centre d’art
contemporain de Vassivière en 1995 trois maisons de verre dont les
parois intérieures ruissellent d’eau, il rendait également la maison
impénétrable, pur objet de regard. Vannhus ou Maison d’eau est une
sculpture publique, construction en bois, dépourvue de porte et emplie
d’eau jusqu’au bas de ses quatre fenêtres. La nature envahit
l’intérieur de cette maison dans laquelle on ne peut entrer, seulement
regarder.
(15) Jeff Wall, "Kammerspiel de Dan Graham", Bruxelles, éd. Daled-Golschmidt, 1988.
(16) Gillo Dorflès, in Marie-Claude Mc Donald,
"Matérialisations. Production de masse, espace public et convention
archtiecturale dans l’œuvre de Dan Graham", p. 27- 72, "Dan Graham",
Paris, DisVoir, 1995.
(17) Catherine Millet, "Melvin Charney. Explorateur de la mémoire collective", in Art Press, mai 1995, p. 57.
(18) Cf. "Paraboles et autres allégories. L’œuvre de
Melvin Charney 1975-1990", Centre canadien d’architecture, Montréal,
1990 ; Kurt W. Forster, "Contradictions of Preservation and
Destruction" in Architext, MIT, Cambridge, décembre 1983.
(19) Gordon Matta-Clark, IVAM Centre Julio Gonzalez Valencia, Musée Cantini, Marseille, Serpentine Gallery, Londres, p. 208.
(20) Nancy Spector, "Robert Gober : Homeward-Bound" in Parkett, n° 27, 1991, p. 80.
(21) Beatriz Colomina, op. cit.
(22) Nancy Spector, ibidem.
(23) Nancy Spector, op. cit., p. 82.
(24) Cf. l’article de Carolyn Christov-Bakargiev dans ce même numéro sur la maison dans l’arte povera.
(25) Cf. l’article de Pascal Rousseau sur "Le vêtement-habitacle" dans le tome 2 de "La Maison".
(26) Nous ne sommes pas attachés dans cet article à
l’analyse de la représentation de l’espace intérieur dans l’art
contemporain, aux formes de domesticité extrêmement nombreuses mises en
scène par les artistes, mais aux différentes types d’appropriation de
la maison comme "objet" visuel et discursif, afin de voir comment la
maison "demeure" un "objet" sauvegardant un sujet unitaire quand bien
même ses bases seront rendues vacillantes.
(27) Ludger Gerdes, "Thomas Schütte", Von Hier Aus,
Cologne, 1984 ; réédité "A propos du "Modèle" chez Thomas Schütte",
cat. Kunsthalle Bern, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris,
Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven.
(28) Bernard Cache, "Terre meuble", HYX,Orléans, 1996.
(29) Michael Newman, "Artists’Architecture", ICA, Londres, 1983.
(30) Marc Augé, "Domaines et Châteaux", Paris, Seuil, Librairie du XXe siècle, 19889 ; p. 143.
(31) Ibid., p. 171.
(32) Corinne Robins, "Nature is a Mother with a Knife :
The Malevolent Landscapes of Ira Joel Haber in Arts", vol. 52, n° 3,
novembre 1977, p. 96-98 ; cf. aussi Carter Ratcliff, "Notes on Small
Scupture", Artforum, avril 1976, p. 42
(33) Mc Donald, 65.
(34) Jean-Pierre Raynaud, 308
(35) 310
(36) Ernst Bloch, "La maison nouvelle et la clarté
réelle" in "Le Principe Espérance. II Les épures d’un monde meilleur",
Paris, Gallimard, 1982, p. 377.
(37) Cf. l’article de Paolo Virno sur la prison dans ce même numéro.
(38) Robert Kleyn, p. 9
(39) Dan Graham, article paru dans Artforum.
(40) Bernard Cache, op. cit., p. 29.
(41) Sylviane Agacinski, op. cit., p. 32-33
(42) Ibidem.
(43) Patricia C.Phillips, "Siah Armajani" in Artforum, New York, décembre 1985, p. 152.
(44) Ibid.
(45) Ibid., p. 142
(46) Ibid., p. 143
(47) Siah Armajani, "Contributions anarchistes
1962-1994," Nice, Villa Arson, 3 juillet-2 octobre 1994, p. 73. Cf.
aussi Calvin Tomkins, "Siah Armajani. Profiles" in the New Yorker, 19
mars 1990 ; Paola Antonelli, "Siah Armajani 1968-89" in Domus, février
1990 ;
Jean-Christophe Ammann, "Siah Armajani", Kunsthalle Bâle, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1987.
(48) Mark Kremer, Stedelijk Van Abbemuseum, 1994 : "For
the past year I have been working on a video and a scale model of a
house... Another purpose of the house is similar to the purpose of an
exhibition... various parts of the house have the effect of a work of
art... So a walk round the house can be seen as a walk round an
exhibition"
(49) Luc Deleu, "Éthique de l’architecture", Tarabusta Editions, 1989 ; "Manifesto to the Order", Guy Schraenen, Anvers.
(50) "Cildo Mereiles", IVAM Centre del Carme, 1995.
(51) "Some Notes on My Pictures of Houses", 15 janvier 1996 (non publié).
(52) Paul Virilio, "L’espace critique", Paris, Christian Bourgois, 1984.

n19- Ami (e) de Forum
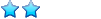
-

Points : 5108
Nombre de messages : 140
Age : 32
Localisation : mosta
Emploi/loisirs : etudiente
Date d'inscription : 14/10/2010
 Sujets similaires
Sujets similaires» Composition spatiale par la superposition et la juxtaposition
» slt.tous mnd je veut une idée sur composition volumétrique
» architecture LMD help ...
» Architecture sumérienne
» ARCHITECTURE ISLAMIQUE
» slt.tous mnd je veut une idée sur composition volumétrique
» architecture LMD help ...
» Architecture sumérienne
» ARCHITECTURE ISLAMIQUE
Archi27 :: DPT d'Architecture :: Amphi :: Les Cours & Les TD :: 2eme année
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|
![Composition visuelle [architecture] I864209_Image1](https://2img.net/h/photomaniak.com/upload/out.php/i864209_Image1.png)




